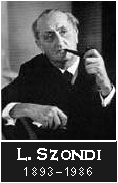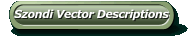
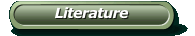







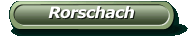

|
||||
 |
 |
|||
|
SZONDI - RORSCHACH : INTERANALYSE A PROPOS DU TRAUMATISME DU POINT DE VUE DE L'AFFECT Jean KINABLE
Mon propos se développera en deux temps. Une première étape explicitera ce choix du
terme « interanalyse » pour évoquer l'usage conjoint de ces deux
méthodes projectives dont la pratique sur le terrain est sans doute plus
fréquente que l'on n'en trouve des échos dans les publications de la
littérature consacrée à la psychologie projective. Or, cet usage conjoint peut
se déployer sur l'ensemble des formes et figures de la psychopathologie, tout
autant qu'il peut concerner, a priori, n'importe quelle problématique
rencontrée par la clinique en matière de santé, mentale et somatique tout
ensemble. S'il en va bien ainsi, discuter des principes méthodologiques d'une
telle conjonction d'instruments et de leur mise à l'épreuve des questionnements
cliniques pourrait nous entraîner à devoir trop embrasser, et donc mal
étreindre, l'ensemble des thèmes et interrogations à traiter que fait surgir un
pareil projet. Aussi mon propos se concentrera-t-il, en un second temps, sur la seule question du traumatisme, laquelle me
paraît pouvoir tout particulièrement bénéficier d'une telle interanalyse.
Expliciter en quoi et tenter de le montrer ne pourront se faire que d'une
manière partielle. Avoir retenu le traumatisme se justifie aussi par
l'actualité de ce thème de recherche dans plusieurs travaux en cours où je suis
impliqué, notamment la thèse de doctorat de Fiorella Febo au sujet des grands
brûlés, thèse dont l'un des mérites consiste dans un effort soutenu, si rare,
pour entretenir le parfois difficile dialogue entre interprétations szondiennes
et rorschachiennes. Autant donc, au seuil de cet exposé, commencer par un avertissement : si le titre annonce un
propos ambitieux, vu l'ampleur du sujet, au risque d'avoir suscité des attentes
d'ordres fort divers, l'on ne peut procéder, cependant, qu'en opérant des choix restrictifs, en espérant que
ceux-ci présentent quelque pertinence,
mais en ne prétendant nullement à la moindre exhaustivité. Les options prises ci-dessous seront donc
nécessairement critiquables : opérant par découpage délimitatif et ne retenant
que ce qu'il décide de prendre en compte, un choix, quel qu'il soit, s'avère
toujours coupable en regard de ce que, injustement, il a laissé à l'abandon, en
marge ou en jachère, le réservant peut-être à plus tard pour une prise en
charge ultérieure. En attendant cette éventuelle reprise, considérons un tel
reste comme la «part laissée à l'autre»[1]
selon la fameuse formule de J. Schotte pour qualifier le profil théorique
complémentaire déduit lors de la passation du Szondi au vu des choix
posés. En outre, gageons que mes options
trouveront à se justifier des quelques propositions qu'elles auront rendues
possibles. Une difficulté supplémentaire
cependant, qui s'est imposée à moi pour l'effectuation de ces choix, est la
suivante : au sujet de chacun des deux tests, il est aléatoire de mesurer les
connaissances et compétences présumables de la part de l'auditoire, vu cette
tendance trop fréquente dans la formation
aux méthodes projectives (une fois dépassée, du moins, cette prévention
encore plus fréquente, chez le clinicien idéalisant le thérapeutique, que
l'usage de tests n'appartienne pas aux tâches suffisamment nobles auxquelles se
vouer – sans parler des anathèmes de la part de certains tenants de la
thérapie) tendance donc à se spécialiser dans une seule méthode à l'exclusion
des autres. Si la présence à un colloque dit szondien autorise de tabler sur un
minimum d'intérêt et d'expérience au sujet du test de Szondi, il n'en va sans
doute pas de même, ni de façon équivalente, en ce qui concerne le Rorschach.
Aussi est-ce à son propos surtout que mes considérations risquent de paraître
en dire trop ou trop peu. Trop : rappels inutiles ou vues peut-être
inédites mais insuffisamment poussées. Trop peu : supposant connues des
informations manquantes ou négligeant l'évocation d'expériences qui
permettraient d'apprécier la pertinence des propositions avancées. Mais foin de précautions, venons-en au vif du sujet. QU’ENTENDRE PAR INTERANALYSE ? Pour aborder notre thème, il faut donc préciser ce qui est
visé par le terme d' « interanalyse ». En effet, une procédure
classique, pour l’usage conjoint de plusieurs instruments projectifs, est d’engager
une démarche de différenciation et de
confrontation. Celle-ci passe par des
rapprochements et des mises en correspondance tant de conceptions théoriques
que de résultats testologiques. Elle enquête, d’une part, en testant la
confirmation, l’infirmation ou l’approfondissement des diagnostics issus des
méthodes respectives, d’autre part, en éprouvant la vérifiabilité des
conceptions nosologiques, mais aussi en examinant les problèmes de validation
spécifiques à chacun des instruments dans leur efficacité clinique (laquelle ne
se réduit pas au seul diagnostic), tout en tentant éventuellement une
validation de l’un par l’autre, et réciproquement. Les cheminements
dès lors empruntés suivent plusieurs voies. Trois sont évoquées ci-dessous,
sans établir d’ordre de préséance entre elles. 1° Mesurer au plus juste la portée révélatrice des données
projectives fournies par chaque instrument. On tentera, d’une part, d’élaborer
ou de renouveler les méthodes de lecture et d’analyse permettant d’élucider, de
déchiffrer et de systématiser une telle puissance de révélation ; d’autre
part, on cherchera à rendre compte des mécanismes
mêmes d’une telle révélation, au travers des fonctions mises en jeu par la
personne pour répondre à la tâche que le test demande d’elle. L’analyse
évaluative de cette portée révélatrice conduit à préciser ce qui se donne à
connaître, ou pas (ce qui en échappe) à la faveur de telles médiations instrumentales. Ceci en ce
qui concerne le diagnostic possible du psychisme, soit les questions suivantes :
- comment
se structurent la réalité psychique
et le fonctionnement de la subjectivité
dans leurs rapports aux situations de la réalité extérieure et de
l’entourage ; - selon
quels processus s’ouvre et s’établit cette « autre scène », à la
topographie complexe, que l’on appelle l’espace psychique ou la sphère
mentale ; - selon
quels mécanismes producteurs fonctionnement, s’organisent et se dramatisent, dynamiquement et économiquement en ces lieux spécifiques, l’élaboration mentale par
l’appareil psychique à penser et la construction-formation de l’intéressé par
le système instanciel de la personnalité ; - comment y
repérer les indices des diverses logiques de structuration caractéristiques des
différentes formes de psychopathologie. 2° Comparer, pour un même sujet, les
portraits ou profils de personnalité résultant des données projectives, tout en
les confrontant aux autres données cliniques recueillies par ailleurs. Ici les points de divergence sont peut-être les
plus intéressants en ce qu’ils peuvent nous indiquer au moins deux
choses : - en quoi
consiste la sphère de révélation spécifique à chaque test, en correspondant
chacun à tel registre de fonctionnement du psychisme susceptible dès lors de
venir s’y manifester électivement ; - en quoi
le sujet est capable de différer de
lui-même (tout autant que de ce que l’on saisit de lui), plutôt que d’être
toujours égal à lui-même ou de se répéter à l’identique ; en quoi il
dispose donc d’une gamme variée de ressources mobilisables dans le travail
clinique. 3° Interroger les théories de
référence tant au sujet de la méthode qu’en matière de psychopathologie[2]
et poursuivre le travail de conceptualisation,
compte tenu également des évolutions historiques que connaissent la pathologie
et la santé. De ces différents points de vue, il
est bon de rappeler que le test de Szondi et celui de Rorschach ne sont point à
égalité ni en situation équivalente. Des différences notables se marquent quant
à leurs possibilités d’utilisation, ainsi qu’en ce qui concerne la part prise
par la théorisation et les avancées de celle-ci. 1. Du point de
vue de la passation, tout d’abord,
le Szondi peut prétendre davantage à
une quasi universalité, hormis certains cas où le simple choix demandé paraît
impossible au sujet, compte tenu de son état pathologique, ou semble perdre
toute signification, en raison d’une déficience mentale trop profonde. En
revanche, le Rorschach relève de
conditions d’applicabilité plus restreintes dans la mesure où la tâche demandée
non seulement exige, de la part du sujet, la capacité de mettre en oeuvre
dialectiquement plusieurs gammes de fonctions mentales d’ordres distincts, tout
en passant par une mise en mots, mais cette tâche dépend aussi des dispositions
présentes, liées à des circonstances conjoncturelles, dispositions dans
lesquelles le sujet se trouve à l’égard de cette sollicitation à exercer, via
la parole, ses compétences propres ou ressources personnelles disponibles.
Aussi est-il dans la logique du dispositif même que la performance d’un même
sujet puisse varier selon les situations et les moments : l’entreprise de
l’épreuve de passation garde toujours un aspect aventureux et imprévisible
quant à ce dont la prestation, finalement obtenue, pourra être tenue pour
représentative et significative. Alors que, à l’inverse, un profil szondien,
d’une passation à l’autre comme d’un sujet à l’autre, présente une façon de
faire son jeu « complet » par rapport à un même et égal ensemble de
cartes à jouer. 2. Du point de
vue du rapport théorie-pratique, la
situation des deux tests a quelque chose d’un positionnement inverse l’un de l’autre. En effet, mort
prématurément avant d’atteindre la quarantaine, Rorschach n’a eu le temps que de présenter son instrument et nous
léguer quelques principes méthodiques d’interprétation pour en jouer
cliniquement, instrumentistes que sont appelés à devenir tant le patient que le
clinicien. Au cours de sa longue vie, Szondi
s’est employé à élaborer les résultats accumulés par la pratique de son
dispositif expérimental et à déployer les implications nosologiques, voire
thérapeutiques, du système pulsionnel qu’il avait établi. On sait aussi comment
et dans quelles orientations, à la suite des travaux de J. Schotte, la dite
« école de Liège-Louvain »[3]
a poursuivi diverses élaborations théorico-cliniques. Tant et si bien que, en
forçant quelque peu le trait, nous pourrions mettre en contraste nos deux tests
en disant ce qui suit. 2.1. Le
recours au test de Rorschach a connu
une très large diffusion pour de multiples usages, ce qui n’a jamais cessé de
confirmer l’efficacité clinique de la méthode, tandis que la théorisation
susceptible de rendre compte, en la fondant, d’une telle expérience a plutôt
mal suivi et
s’avère toujours quelque peu en reste. Les modèles théoriques les plus divers
ont été utilisés pour analyser et interpréter les protocoles du Rorschach. Sans
doute cela fait-il partie de cette richesse intrinsèque propre à l’instrument
qu’il se prête ainsi à plusieurs abords théoriques possibles. Par ailleurs, le
praticien pourra légitimement bénéficier de tout le reste de son expérience
clinique et s’en référer à des paradigmes théoriques hétérogènes pour
interpréter des résultats qui paraissent assez immédiatement parlants
d’eux-mêmes. Initiée par D. Anzieu, poursuivie notamment à travers les travaux
du laboratoire de C. Chabert, une importante école française a choisi la
référence psychanalytique, tout en privilégiant les confrontations avec le
T.A.T. 2.2. Aisés
à recueillir, les profils szondiens
ne deviennent parlants que grâce à un appareil théorique exigeant et complexe à
maîtriser. L’intérêt du schéma pulsionnel légué par son concepteur a donné lieu
à des développements théoriques qui
ont pu paraître s’émanciper du lien à la pratique
testologique : ces théorisations prétendaient pourtant, par le
déploiement des virtualités du système, établir de nouvelles conditions de
possibilité préalables à une lecture approfondie, voire inédite, non seulement
des résultats obtenus au test, mais aussi de l’intelligibilité des pathologies
examinées, ainsi que de bien d’autres témoignages cliniques, notamment issus
d’oeuvres culturelles, d’organisations institutionnelles[4],
de formations collectives, etc. Cependant, ces développements resteraient en
attente d’attestations clinico-testologiques plus décisives. Ainsi, par
exemple, dès 1966 un A. Vergote, à l’occasion de son étude intitulée
« Complexe d’Oedipe et complexe de Caïn », terminait-il son travail
en déclarant : « La question reste ouverte de savoir si un test
d’analyse pulsionnelle peut dévoiler cette forme nouvelle [à savoir, en
l’occurrence, l’instauration, en tant qu’instance psychique, de la conscience
éthique]. Et si oui, comment ? » (1971, p. 454). Une telle
interrogation ne nous a jamais quittés. On pourrait également la formuler en se
demandant ce qui, de nos spéculations théoriques inspirées de la rencontre
entre nos expériences cliniques et nos conceptions du système szondien, trouve
à s’inscrire dans les profils résultant du test et à éprouver sa pertinence
pour l’étude de cas singuliers[5].
Une autre façon encore d’aborder le même problème, en partant cette fois des
données testologiques, est de considérer ce qui suit : les profils nous
fournissent bien des formules de composition qui configurent les facteurs
racines, les plus radicaux pour la production des phénomènes, et qui sont au
principe d’un large éventail de modalités d’actualisation possibles, très
diverses, sous des formes de manifestation d’ordre pathologique tout autant que
ressortissant à la santé ou à une socialisation de bon aloi. Dès lors la
question reste ouverte de rechercher les indices (tenant sans doute à la
dynamique d’ensemble) qui permettraient d’évaluer laquelle de ces
actualisations possibles, de natures si différentes, se joue dans le cas
concerné. La lecture de l’ouvrage de S. Déri (1998) en est particulièrement
démonstrative : chaque configuration de signes voit sa signification
s’emplir de valeur et de sens variables selon l’âge de l’intéressé et la phase
de son devenir, ainsi que suivant qu’elle se présente sous une version morbide,
caractérologique, normalisée, socialisée dans une option professionnelle,
motivant un choix relationnel, etc. Mais comment décider, à partir du seul
test, de la version selon laquelle cette configuration racine se traduit cliniquement ? C’est peut-être là qu’une
interanalyse rend certains services et apporte une contribution intéressante.
En une sorte d’échange de bons procédés
entre méthodes, la conceptualité Schotto-Szondienne nous fournit une grille
d’analyse pour enrichir la lecture des phénomènes engendrés au Rorschach,
tandis que, en retour, ceux-ci peuvent témoigner des versions manifestes sous
lesquelles se trahissent les configurations de facteurs racines qui seraient au
principe actif de leur production. Ainsi, dans les confrontations entre ces
deux types de données projectives, comme avec des données cliniques d’autres
provenances (entretiens, anamnèse, narration, séances de thérapie, ateliers
d’activité culturelle ou artistique, etc), l’interprétation-déconstruction d’un
même corpus de données devient un analyseur potentiel pour l’intelligibilité
des autres, et réciproquement. Ces préliminaires étant posés,
passons à la problématique du traumatisme :
elle représente un lieu commun aux
deux méthodes, lesquelles en offrent aussi un abord original, propre à chacune. CLINIQUE DU TRAUMATISME Un fait diffère
d’un événement. Si brutal soit-il
dans sa survenue, si violent soit-il dans son effet de choc, si annihilant dans
son impact subjectif, si maléfique dans ses conséquences, ... si atroce ou
effroyable que soit la teneur dramatique de son déroulement, si évidentes que
soient ses atteintes les plus purement objectives à l’intégrité de qui le
subit, le fait brut, dans sa réalité factuelle (dont certains ont prétendu établir
des échelles de gravité), ne suffit pas encore à autoriser de parler ni
d’événement traumatique ni de traumatisme psychique. Passer du fait à
l’événement à proprement parler, c’est-à-dire du fait tel qu’il serait
descriptible et constatable de l’extérieur, tel qu’on peut prétendre en établir
la réalité (matérielle) et décider de sa vérité (objective ou tranchée
judiciairement), passer de pareil fait à ce qui fait véritablement et
authentiquement événement existentiel,
événement d’une histoire de vie, événement vécu en propre et en personne par
l’intéressé auquel il appartient de pouvoir réaliser ce qui lui arrive et
éprouver la vérité de ce qu’il en advient ainsi de lui, un tel passage implique
l’entremise de la subjectivité, de la
personnalité et du psychisme. De même, parler de
traumatisme, en le qualifiant de « psychique », pointe l’effet
produit par l’événement chez le sujet dans le registre psychique, tout à la
fois intra- et interpersonnel sans doute, mais en tant qu’il faut en affirmer
l’autonomie et l’autologie, tant vis-à-vis du biologique que vis-à-vis du
socio-économico-culturel. Un thérapeute[6]
peut prendre pour option thérapeutique (souvent
parce qu’il y voit une condition de possibilité nécessaire, préalable à toute
élaboration psychique) d’insister sur l’exogénéité foncière de l’événement
(assurant à la victime de n’être pour rien dans la survenue même du fait). Il
peut insister également sur l’importance à accorder à la réalité
événementielle, sur le soutien d’une démarche pour obtenir reconnaissance et
réparation qui soient d’ordre social, voire en justice. Il n’empêche que le
travail psychothérapeutique porte sur l’endogène et la mise en cause de
soi : il concerne (et oeuvre sur) la dramaturgie interne des processus
mentaux, en particulier l’activité fantasmatique (ressortissant à la réalité
psychique) à l’occasion et à propos de l’événement critique. A lire Freud, on peut voir se discerner deux appréhensions différentes du traumatisme : d’une part,
en tant qu’événement, incident
historique dont la contribution à l’étiologie de diverses pathologies est
envisagée ; d’autre part, un trauma inéluctable, obligé et d’un tout autre
ordre, tel un fait de structure et un
effet de structuration, appartenant
constitutivement ou constitutionnellement aux conditions mêmes (aux
« lois ») du système pulsionnel, de l’organisation psychique et de la
construction de la personnalité. Or justement, nous pourrions considérer que le
test de Rorschach se prête électivement à la survenue de phénomènes équivalents
au traumatisme en tant qu’événement existentiel, tandis que le test de Szondi
inscrit, dans le schéma pulsionnel qui le fonde, une acception structurale du
trauma. Au Rorschach c’est
le phénomène particulier dit de « choc » justement qui en est tenu
comme paradigmatique et qui offre l’occasion d’une analyse de la
traumatisabilité actualisée du sujet. En ce qui concerne le Szondi,
dans notre effort de circonscrire les spécificités de chaque vecteur et de
définir les coordonnées aptes à articuler les enjeux propres à chacune des
scènes de la topique pulsionnelle, le concept de trauma figure en bonne place parmi ces coordonnées, où il a tout
particulièrement partie liée avec l’un des fantasmes
originaires et avec une forme d’angoisse
singulière. Des propositions pour en formuler la teneur spécifique selon les
vecteurs circulent dans l’ouvrage de Ph. Lekeuche et J. Mélon
« Dialectique des pulsions ». Ainsi y est-il notamment
question : du traumatisme de « séparation » (qu’il s’agisse de
la « naissance » ou du « sevrage ») pour le vecteur C, de
celui d’ « intrusion » ou de « perte d’objet » pour le
vecteur S, de celui de la « différence des générations » pour le
vecteur P et enfin de celui de la « différence des sexes » pour le
vecteur Sch. Corrélativement, les fantasmes originaires seraient
respectivement : celui du « retour au sein maternel », celui de
« séduction », celui de la « scène primitive » et celui de
« castration » – dont l’avers serait celui d’ « auto-engendrement »
ajouterais-je. Quant aux formes d’angoisse correspondantes : celle
d’ « abandon » ou de désaide (Hilflosigkeit), celle de
« vide » ou de « perte », celle de « culpabilité, de
faute et de punition », celle de « dépersonnalisation » enfin,
ou de (dé)responsabilisation dirais-je. A partir du système de concepts
métapsychologiques ainsi mis au point, en relisant ensemble Freud et Szondi
à l’aide de Schotte, indépendamment même du recours à l’instrument
testologique, nous disposons également d’une grille d’analyse pour déconstruire les composantes et les
mécanismes d’un événement traumatique, quel qu’il soit. En un premier temps, tel traumatisme particulier peut trouver à se
définir par celui des registres
existentiels (tels que discernés par la topique szondienne) où situer le point
d’impact auquel sa puissance d’effraction porte atteinte. En même temps sont
repérées la dynamique et l’économie vectorielles dont ses effets de choc
viennent, tout à la fois, altérer et instiguer l’efficacité productive, mettre
en échec et au défi la mécanique défensivo-promotionnelle, provoquer la stupeur
et le tremblement, entraîner la sidération, la confusion, la désorganisation,
le débordement, l’incapacitation... mais aussi l’impérieuse nécessité de
restauration, de reconstruction, voire de transformation. Ainsi, par exemple,
analysera-t-on volontiers la teneur critique d’un viol (ou autre agression
sexuelle) selon la logique propre au vecteur S. C’est-à-dire, notamment, dans
ses effets de ravalement du sujet au statut d’objet instrumentalisé pour les
besoins de la jouissance d’un autre, au mépris de tout désir de sa part,
jusqu’à perpétrer une mise à mal/mort de sa position de sujet ; on pourra
l’analyser également en tant que transgression de la loi du change et de
l’échange ; dans ses correspondances avec la fantasmatique de séduction et
la reviviscence d’éventuels épisodes d’abus de cet ordre ; dans son
efficience à pétrifier ou à solliciter la dramatisation des ressorts
pulsionnels où s’enracine la vie sexuelle. En
outre, le système szondien invite également à poursuivre l’analyse dans le
sens des conséquences et des répercussions sur l’ensemble des trois autres registres : tant ceux de l’humeur et
des affects que celui du moi, registres où les crises qui leur sont spécifiques
peuvent s’en trouver provoquées : perte d’une confiance de base en un
univers participatif et en une communauté d’appartenance ; sentiment
d’injustice réclamant vengeance ou réparation ; mise en cause d’une
culpabilité ou d’une responsabilité personnelles ; rupture de la continuité
d’être et restauration de soi encore en souffrance, etc. Rorschach et événement traumatique En quoi et comment le Rorschach offre-t-il les conditions de
possibilité pour une actualisation de la traumatisabilité du sujet et
propose-t-il de mener une analyse du traumatisme en tant qu’événement ? Ici nous serions nécessairement conduits à remobiliser toutes
ces notions freudiennes capitales qui
gravitent autour d’une telle acception du traumatisme, à savoir entre
autres : l’inscription de traces (indélébiles, mais de quel ordre ?)
aux destinées variables, l’amnésie et le refoulement, l’après-coup,
l’incapacitation du psychisme à maîtriser et à élaborer la charge d’affects due
à un excès énergético-économique. Je m’en tiendrai à quelques indications polarisées, comme je
le ferai ensuite à propos du Szondi, sur la question de l’affect. En effet, cette communication m’a été l’occasion de
travailler davantage le vecteur P alors que mes précédents travaux[7],
souvent présentés en ce cénacle, avaient concerné préférentiellement les trois
autres. Il convient sans doute de commencer par rappeler quelques principes de fonctionnement de
l’expérience Rorschach, notamment quant à ce qu’elle met à l’épreuve dans le
chef du sujet. Celui-ci est mis en présence d’un matériau (celui des taches)
d’autant plus étrange qu’il est dépourvu de sens : d’une signification
préétablie, quelque peu énigmatique sans doute mais qu’il suffirait de
dévoiler, signification déjà là qu’il faudrait pouvoir reconnaître... en
traitant cognitivement des informations fournies. Ce matériau insensé, ou non
encore sensé, lui tombe dessus comme par hasard mais dans une intention mal
identifiable de la part de qui le lui propose, quoi qu’il en dise. Aussi cette
mise en présence est-elle une expérience de vacillation des repères,
d’instabilisation des références, de défaillance d’un quelque chose d’extérieur
qui soit sûr et certain, auquel pouvoir se raccrocher et s’en tenir. Pour se
faire le sujet de pareille situation, ainsi qu’il est appelé à le devenir, le
testé se doit, à l’instar du Dieu Créateur de La Genèse, d’engendrer un monde
qui ne pourra qu’être sien et à sa ressemblance. L’opération primogénétique est
de procéder à des partages qui discernent et répartissent, discriminant le ciel
de la terre, l’océan des continents, le jour de la nuit avant que de peupler
l’ouverture du monde, ainsi constitué entre ciel et terre, des divers règnes du
vivant pour terminer par l’homme créé à son image. Pour procéder de même, le
sujet, contraint à la liberté, n’a d’autre marche à suivre que celle qu’il
inventera en la tirant de lui-même. C’est pourquoi et en quoi les productions
qu’il engendrera porteront témoignage des processus mentaux producteurs engagés
dans leur élaboration. Cette mise en situation comporte une dimension ou un
potentiel foncièrement critique,
allant de l’étonnement au véritable choc. Elle peut dès lors fonctionner comme
modèle de crise existentielle et provoquer le rappel de toutes ces crises
fondamentales qui, dans une biographie, sont des moments pivots, des tournants
décisifs, des seuils de passage métamorphosant, des noeuds articulatoires ou de
structuration pour le devenir du sujet (et ici, l’on voit poindre le trauma au
sens structural). On pourrait tout aussi bien dire que cette situation,
littéralement surprenante, est susceptible, par là même, de devenir un modèle
de tout événement (au sens radical du
terme) c’est-à-dire de tout événement dont la survenue, dans l’existence, met
celle-ci en demeure d’exercer ses propres pouvoirs d’exister par elle-même :
se pouvoir elle-même et pouvoir être elle-même par elle-même, y pouvoir quelque
chose grâce à ses propres ressources, en mettant à l’oeuvre cette puissance
endogène qui lui revient dans ce qu’il peut en advenir d’elle-même –
transpassiblement et transpossiblement dirait sans doute H. Maldiney[8]. Pour arriver à ce que la personne puisse, en pareille
situation, dire quelque chose à propos de quelque chose, il lui faut se
déterminer, en engageant du même coup une auto-détermination d’elle-même, et se déterminer doublement : d’une
part, découper, délimiter, départager ce qu’elle prend en compte, discerner ce qui sera le sujet de son
interprétation ; d’autre part, décider
du prédicat qu’elle lui attribuera, sélectionner l’aspect sous lequel elle
le prendra en considération, opter pour ce qui la déterminera, selon sa
sensibilité élective, et dès lors électrice, à interpréter suivant telle
direction de sens. La première de ces déterminations s’analyse en termes de
« localisation » et de « mode d’appréhension » : elle
permet au sujet de situer ce dont il s’agit et donc de se situer, de se
repérer, de s’y retrouver, de savoir où il en est quant au « il y a »
de son « être là ». La seconde détermination s’analyse en termes de
« déterminants » : Rorschach en a établi de 4 à 5 catégories.
Deux entretiennent un rapport électif avec l’aspect configural, voire dynamique,
des données tandis que leur mise en correspondance a été proposée, notamment
par C. Chabert, avec le représentant psychique du pulsionnel qui est de l’ordre
de la représentation : il s’agit
de la forme et de la kinesthésie. Les deux (ou trois) autres ont une affinité
élective avec l’aspect sensoriel des
données, tandis que leur mise en correspondance équivalente s’est faite avec
les représentants pulsionnels de l’ordre de l’affect : il s’agit de la couleur et de l’estompage, ainsi que
du clair-obscur lequel est transversal aux deux précédents dès lors que ces
déterminants ont un impact anxiogène – tant il est vrai que l’angoisse
représenterait cette sorte d’étalon-or dans lequel tout affect serait convertible, autant qu’il est apte à se somatiser. Pour ma part, j’ai l’habitude de travailler dans l’hypothèse d’un rapprochement, du moins
sur certains points, entre le vecteur C et l’estompage, le vecteur S et la forme,
le vecteur P et la couleur, le vecteur Sch et la kinesthésie. Si le matériel proposé à la créativité du sujet par ces
données offertes à sa réception, si ce matériau est insensé, il s’impose
cependant tel un morceau de réalité présentant des caractéristiques objectives
et des propriétés patentes, variables d’une planche à l’autre à travers des
constantes et des innovations. L’expérience clinique démontre que la réception
par le sujet de pareilles données voit se développer toute une dialectique entre manifeste et latent
que l’on pourra appeler la « puissance d’évocation symbolique » des
planches : au sens où viennent se transférer,
dans la situation de passation du test, en s’accrochant à telle ou telle
caractéristique manifeste des données, des formes typiques de
conditions-dispositions rencontrées dans l’existence, lesquelles renvoient à
des prototypes originaires dans l’histoire de la personne, au cours des
différentes phases et positions du devenir, qu’on les appelle complexes
familiaux, constellations psychologiques ou crises structurelles et
structurantes. S’y transfèrent donc des imagos, des scénarios fantasmatiques,
des réminiscences d’affects, des épisodes de vie critiques, voire traumatiques,
des mises en cause (ou à la question) de l’intéressé dans ce qu’il peut
psychiquement et personnellement eu égard à des problématiques essentielles de
l’existence. Dans un effort de systématisation des observations cliniques[9],
on cherchera à thématiser à quoi tient cette puissance de transfert, c’est-à-dire
tant ce qui, des circonstances contingentes, peut le provoquer, que ce qui peut
ainsi venir s’y transférer. Il s’agit donc, d’une part, d’élucider ce pouvoir
des données (sous condition de leur réception par le sujet prédisposé et
sensibilisé par son histoire) d’autre part, d’analyser en quoi consiste ce
processus de transport et ce qui en fait l’objet : de quoi y a-t-il ainsi
réévocation et transposition. Ce processus s’engendre donc dans l’entre deux d’un double à partir :
dans la rencontre et l’interaction entre l’exogénéité
de la réalité du monde extérieur et l’endogénéité
de la réalité psychique dont l’ « endon » le plus radical prend
souche dans le fonds pulsionnel. Cette condition d’avoir à s’entremettre et s’entreprendre
à partir d’une double source, endogène et exogène, c’est aussi celle de
l’instance du moi (J. Kinable, 1990) et du for intérieur ou du quant-à-soi du
psychisme, dans son autonomie et son autologie. Or justement, le traumatisme ne
consisterait-il pas, à la limite, en une façon pour l’exogène de l’emporter au
point de bloquer toute genèse, jusqu’à empêcher la moindre oeuvre, en mettant à
mal, voire en court-circuitant et laissant hors jeu ce qui pourrait se dérouler
depuis et dans l’en-dedans du psychisme ? Le phénomène de choc
en serait donc un équivalent atténué : paradigme
d’événement traumatique, il s’avère également le révélateur particulièrement démonstratif de ladite puissance
d’évocation symbolique de chaque planche. Disons un mot de ces deux points. 1. Ce
phénomène de choc a été identifié de prime abord par Rorschach à propos de
l’impact de la couleur, avant qu’il ne s’avère que toute particularité des
données était susceptible d’en provoquer également. Rorschach le décrit tel un
passage à vide où le sujet, sous l’impact des données, reste comme interdit, à
quia ou le bec dans l’eau, empêché quant à proposer une interprétation. Il y
voit une réaction de stupeur affective : le sujet demeure surpris
(c’est-à-dire pris par un surcroît excessif de ce qui se sollicite en lui), en
état de perturbation émotionnelle qui entraîne soit une incapacitation de la
pensée, un blanc dans l’activité d’élaboration, de liaison ou de symbolisation
de ce qui se passe, soit des tentatives malhabiles et maladéquates de
compensation ou de dépassement de cet état critique, en recourant
substitutivement à certaines fonctions psychiques encore mobilisables.
Rorschach y perçoit un indice de névrose et en conçoit la mécanique interne sur
le modèle du refoulement, considérant
que l’impact de la couleur a pour effet de susciter la montée d’affects, tandis
que la représentation figurative manque à l’appel pour permettre quelque liaison de ces pression et énergie
pulsionnelles mobilisées. On voit comment prolonger de telles analyses dans le
sens des développements freudiens autour du traumatisme. 2.
Susceptible de se produire à tout propos, c’est-à-dire à l’occasion de
n’importe laquelle des propriétés manifestes des données, lorsqu’il survient,
le choc devient le révélateur particulièrement significatif pour faire saillir
deux choses. Premièrement, selon celle des planches qui met ainsi le sujet en
difficultés, selon ce qui dans les données de celle-ci prend un tel impact, en
quoi consiste la vulnérabilité du
sujet : quelles sont ses zones de fragilité et les lignes de fracture
possible selon lesquelles son psychisme risque de se briser, en fonction de sa
façon de s’être organisé et construit. Deuxièmement, selon la gamme des
mécanismes de défense et de promotion que le sujet parvient à
engager pour s’en sortir, assiste-t-on à la perpétuation
ou à la transformation des principes
du style de la logique de fonctionnement selon laquelle le sujet s’était
constitué jusque là. Quand on sait par avance qu’une personne a subi dans sa vie
des faits incontestablement traumatisants
(ce qui ne préjuge pas encore de la façon dont l’intéressé en a fait un
événement traumatique aux effets éventuellement pathogènes), qu’il s’agisse par
exemple d’accidents ayant provoqué de graves brûlures ou de violences
sexuelles, on sera attentif à des indices tant d’une probable évocation de leurs traces que de
l’éventuelle poursuite d’un travail
d’élaboration de celles-ci, à l’occasion et à la faveur du faire oeuvre en quoi consiste la tâche
du sujet au Rorschach. La démarche est comparable, même si elle va en sens
inverse, à celle d’un Freud dans son analyse de certaines oeuvres d’art en
particulier, comme certains tableaux de Léonard de Vinci. Freud explique
diverses particularités de telles productions picturales à partir de certaines
singularités de la biographie de son auteur, en référence à des conditions
décisives qui ont pu orienter le destin de celui-ci. On connaît aussi, dans son
travail d’analyste, la part de reconstruction d’épisodes ou de scènes
permettant de réaliser ce qui a bien
pu se passer, à la rencontre du double à partir d’où cela s’est engendré. Le
faire oeuvre, actuellement au Rorschach, ne peut se produire que à l’image de
celui que requièrent l’existence et la dramatisation historique de celle-ci. Ce
sont, en effet, les mêmes mécanismes
mentaux qui, d’une part, sont ceux par lesquels le sujet organise, depuis
toujours et tout au long de son histoire, son monde intérieur ou sa réalité
psychique et cela sous l’effet exogène, d’un côté, de ce qu’il lui advient
comme événement et, d’un autre côté, des interactions qu’il entretient avec
l’entourage, les autres et le monde ; d’autre part, ces mêmes mécanismes
sont ceux par lesquels le sujet produit, au présent, une certaine oeuvre, comme
lors du Rorschach, laquelle s’organise en rapport avec ce monde intérieur et en
référence avec la situation actuelle. Quand je disais que ce qui se passe au
Rorschach est à l’image de ce qui se passe dans l’existence, cela signifie donc
que les processus (dont l’expérience du test offre l’occasion de faire
l’analyse) sont ceux-là mêmes dont se tisse la tâche d’exister. C’est déjà
l’intervention de ces processus psychiques et de ces fonctionnements personnels
qui fait que le monde intérieur de tout un chacun n’est jamais le pur reflet,
la copie exacte, certifiée conforme, ni la reproduction intériorisée des faits qui lui sont advenus, ou d’une réalité
extérieure telle qu’elle serait définissable objectivement et factuellement.
Réciproquement, c’est aussi l’intervention de ces mêmes processus qui fait que
l’oeuvre produite au test n’est pas non plus la réplique fidèle, le pur
décalque extériorisé, la simple
reproduction projetée au dehors du monde intérieur de celui qui propose
pareille production. C’est notamment ce qui fait, rappelons-le, qu’un événement
existentiel n’est jamais le compte rendu objectif de ce qui aurait eu lieu, un
pur et simple prendre acte et se rendre à l’évidence du fait et du réel, tout
autant qu’une image parentale n’est jamais le portrait fidèle de la personne
réelle. Aussi, dans les cas qui nous
occupent où des faits antérieurs sont déjà connus, l’important serait de
pouvoir analyser comment certains représentants psychiques s’en sont élaborés,
et à partir de quelles données d’ expérience, expérimentées de quelle
façon. Il importerait ensuite d’analyser comment ces représentants se trouvent
remobilisés et utilisés dans la production actuelle. La nécessité du double à
partir se retrouve jusque dans le double
sens du verbe « réaliser » : dans l’existence, il s’agit de
pouvoir réaliser ce qui vous arrive (représenter psychiquement l’expérience que
l’on vit et quelle en est la vérité existentielle, se rendre compte
personnellement de sa signification propre) tout autant qu’il s’agit d’en faire
une oeuvre de réalisation de soi, à travers l’effectuation d’un travail de
production d’oeuvres diverses où se met en acte la réalité interne. Et c’est
bien ce que demande le Rorschach. Dans ce que le sujet va forger comme
représentants psychiques, certains le sont pour que le sujet puisse s’en affranchir en les objectivant
dans une oeuvre qui se détache de lui (ou en les « objectifiant »
dans un produit extérieur, différant de soi), d’autres le sont pour qu’il
parvienne à en instaurer en lui la symbolisation, ainsi construite dans un
effort d’appropriation introjective[10].
L’insistance répétitive de certaines traces factuelles peut traduire l’appel
désespéré à une telle capacité de réalisation appropriative. C’est en tenant compte de tout ceci qu’il devient possible de
saisir la portée significative des
réponses obtenues au test de la part des personnes traumatisées. Deux
illustrations me viennent dont la découverte m’a paru marquante. L’une est
issue des productions recueillies par F. Febo, l’autre provient de plusieurs
recherches différentes auprès d’enfants et d’adultes ayant vécu des abus
sexuels durant l’enfance. Les termes « trauma » et « choc » font
image : ils évoquent un coup pouvant
aller jusqu’à couper : un coup
venant frapper un être ou un corps, mettant à l’épreuve sa résilience, au point
que ce heurt violent ne se contente pas de meurtrir la zone de contact ni
d’ébranler tout l’organisme ainsi atteint. Ce coup, s’il traumatise, va jusqu’à
percer (selon l’étymologie grecque de trauma) sa surface ou son enveloppe par
effraction, en y occasionnant une blessure. Mais justement un autre effet
possible du coup assené est celui de fendre
ce qui en est victime : c’est-à-dire le diviser le plus souvent dans le
sens de la longueur, le couper en deux selon l’axe vertical, le disjoindre de part et d’autre de la fissure ou du
clivage provoqué de part en part de cette ligne de force rectrice qui le tient,
voire qui charpente la poussée de son auto-animation. Tout à la fois elle
rassemble et maintient ensemble les parties dont l’être est composé et elle
indique la direction de sens dynamique de sa croissance, de sa position érigée,
de sa capacité de tenir le coup et de se camper debout. Par ailleurs, la
manière dont le matériel de Rorschach a été obtenu actualise tout
particulièrement un tel axe vertical, tout autant que sa puissance d’évocation
symbolique suscite volontiers l’image du corps considéré frontalement. Le corps
propre s’organise aussi symétriquement autour d’un axe central, pivot de toutes
ses parties qui vont par deux. Or, dans les protocoles de grands brûlés
adultes, si nous trouvons bien diverses manifestations de la mise en cause du moi-peau[11] et du système pare-excitation, il est plus étonnant de constater la fréquence
d’apparition d’entités qui se fendent, au sens que nous venons de voir, tout
particulièrement aux planches les plus unitaires et les plus compactes, dont la
cinquième dite de la représentation de soi (que peuvent se disputer le réalisme
et l’idéalisme). Comme si le choc vous révélait coupable : ici la
matérialité sonore du signifiant offre la licence d’un jeu de mot que
l’étymologie ne permet pas, à savoir l’évocation de la culpabilité. Retenons
déjà que l’on peut aussi « se fendre d’un don » tel le sacrifice de
Caïn (cfr. infra). Chez les victimes d’abus sexuels, dans les protocoles de
Rorschach comme dans plusieurs dessins d’enfant, c’est la présence insistante
des pieds qui est interpellante,
qu’ils soient accentués ou qu’ils soient perçus comme morceaux détachés de
l’ensemble dont ils ne sont qu’une partie. Ne serait-ce pas parce que le pied
incarne cet instrument non seulement du contact qu’entretient le piéton avec
une base portante sur laquelle se (re)poser et prendre fond, mais aussi prendre
appui pour se porter et s’élancer dans son être-en-marche ? Il est aussi l’organe
de ce redressement décisif de l’ « hominescence » comme dit M.
Serres de préférence à l’ « hominisation ». Si Freud (1971, p.
50) l’évoque d’un point de vue phylogénétique (dans « Malaise dans la
civilisation » il fait même de cette verticalisation « le commencement
du processus inéluctable de la civilisation ») dans l’ontogenèse, il
permet à l’enfant d’acquérir la marche et d’ainsi conquérir la liberté de
s’auto-promouvoir à son gré, de son propre fait et en vue de ses propres fins,
vaquant à ce qui le concerne selon ses desiderata personnels, vecteur de
subjectivation. Cette auto-mobilité lui permet également de « se
tirer » : de s’échapper et de se soustraire, plutôt que de rester
livré, figé sur place, à ce que d’autres peuvent sur lui ou se permettent comme
privautés en se les accordant sur sa personne[12]. Szondi et trauma structural Passons à Szondi en nous polarisant sur le vecteur paroxysmal, celui dit des
affects. Pour l’aborder, nous pouvons rappeler quelques perspectives selon
lesquelles ressaisir ces coordonnées
qui permettent de spécifier chacun des registres vectoriels. Un vecteur peut
être considéré en tant qu’il est le lieu
d’une crise et la scène d’un drame
à travers lesquels l’existant humain devient lui-même et qu’il est susceptible
de traverser de façons diverses, plus ou moins constructives ou destructives.
La théorie des circuits (J. Schotte) a établi un trajet logique pour ce passage
et cette traversée. La crise dont question est conçue tel un trauma structurel, en tant qu’elle
serait au principe de l’ouverture même et de l’instauration de ce registre. Il
s’agit là d’une crise que le dispositif des ressorts psychiques (ou des
facteurs pulsionnels) et leur mise en jeu, dialectique ou bloquée, ont vocation
de traiter ou de gérer : on peut les appeler des mécanismes tant de
défense que de promotion de soi dans cette explication en personne avec la
problématique en cause. L’étude desdites formes de clivage (ou configurations
des dynamiques pulsionnelles) cherche à définir quelle est la dramaturgie interne au vecteur, propre à
élaborer (et à se positionner vis-à-vis de) ce qui s’y trouve en cause et en procès, en tant que cause à défendre. Si la crise paraît
résulter d’un trauma obligé, elle met en demeure d’engager une certaine partie,
tandis que les processus et procédures que représentent les facteurs et leurs
configurations possibles sont les cartes et les mises grâce auxquelles la
partie peut se jouer. Ce sont les ressources et fonctions à déployer et à
mettre à l’oeuvre pour mener cette partie. Et il y a plusieurs manières
possibles de « faire son jeu » que l’on pourra identifier comme
correspondant, à chaque fois, à quelque logique pathologique. Une façon d’éclairer de tels enjeux, comme rappelé plus haut,
c’est de préciser quels sont spécifiquement le fantasme originaire (en
l’occurrence : celui de la « scène primitive »), le trauma
causant la crise (celui de la « différence des générations »),
l’angoisse fondamentale encourue (celle de « culpabilité »), la règle du jeu (« tu ne tueras point »).
Il est également diverses manières typique de « faire son jeu » ou
des martingales qui trouvent à
s’incarner dans certaines figures comme celles de Caïn et de Moïse convoquées
par Szondi, ou celles des quatre frères Karamazov si finement analysées par Ph.
Lekeuche (1994), ou encore celle de l’ « Idiot » étudiée par Cl.
Pluygers (1994). Le dessous des cartes ou les mises engagées seraient les affects dont Cl. Van Reeth (1971, p.
492) faisait justement remarquer qu’ils sont « tantôt ce qui permet de décrire
la pulsion P, tantôt ce qui la conditionne, tantôt son objet ». Il faut
préciser ici que si l’on a pris l’habitude d’aborder cette problématique de
l’affect à partir et à propos de certains de ceux-ci, qualifiés de façons
particulières, comme ceux dits caïnesques, brutaux, grossiers, meurtriers
(rapportés à e-) ou encore la pudeur et le dégoût (rapportés à hy-), il
conviendrait de les traiter en paradigmes d’un universel au coeur de n’importe
quel affect, quelle qu’en soit la qualité singulière. Ainsi par exemple, la
rage peut-elle se déspécifier par rapport à son sens premier, lequel concerne
un affect particulier, obligatoirement impliqué, à savoir la colère ou le dépit
dont l’extrême violence rend agressif l’enragé. En effet, la rage peut en arriver
à exprimer l’envie violente ou le besoin passionné (jusqu’à la fureur ou la
frénésie maniaque) de quelqu’ordre affectif que soit cette appétence. Et on
parlera de la « rage de vivre » tout comme on peut déclarer :
« ce n’est plus de l’amour, c’est de la rage ». Selon Freud,
d’ailleurs, l’affect est le représentant de n’importe laquelle des motions
pulsionnelles[13].
Comme celles-ci sont contradictoires entre elles, l’affecté est partagé entre
affects antagonistes et en lutte conflictuelle les uns contre les autres. En
principe, il en est donc de spécifiques pour chacune des tendances et des
configurations pulsionnelles. Mais le vecteur P permettrait d’en articuler les
différentes destinées possibles. La loi fondamentale et
fondatrice, équivalente à celles que j’avais formulées pour le contact
comme celle « de partage et d’appartenance » (J. Kinable, 1990), pour
le sexuel comme celle « du change et de l’échange » (J. Kinable,
1995), serait ici celle « de
reconnaissance et de solidarité ». On pourrait même y ajouter des
épithètes en parlant de reconnaissance paternelle
et de solidarité fraternelle. Partons donc de l’affect. Ce concept nous permettra également
de marquer la distinction avec le registre de l’humeur dans lequel ont cours
les notions de sensation, d’émoi et d’émotion qui sont également utilisées
volontiers pour exprimer l’affect, au risque d’une assimilation
dédifférenciatrice. Ne définit-on pas l’affectivité comme faculté de
s’émouvoir. Or, si l’on peut reconnaître dans l’affect un mouvement au dehors[14]
jusqu’à sortir de ses gonds et se déchaîner, cependant un constituant d’un
autre ordre intervient également qui le spécifie. Entendons le à partir du
verbe dont il provient : en même temps c’est une dimension de tout
traumatisme qui se donnera à percevoir. Affecter : affectation et
affectataire Une brève remarque étymologique[15],
tout d’abord, pour le plaisir d’entr’apercevoir l’intérêt qu’il y aurait à en
développer diverses implications. La racine indo-européenne d’origine a donné
en grec la base « the » qui a engendré le verbe pour dire poser,
établir et prendre (une) position : ainsi est-ce à une même parenté
qu’appartiennent des mots comme hypothèque (en tant que gage qui sert de
fondement), thème, thèse et la fameuse prothèse (toxicomaniaque). Tandis qu’en
latin elle a donné lieu à deux variantes : la première en
« der » a donné le verbe « dere » comme dans
« credere » signifiant « faire foi » ; de la seconde,
en « f », comme dans le verbe « facere », proviennent,
d’une part, « afficere » au sens de mettre dans une certaine
disposition, d’autre part, lorsque la base est « fect »,
« affectere » au sens de feindre, rechercher, attribuer, toucher.
C’est à cette parenté qu’appartiennent tous ces termes si pertinents en ce
registre existentiel comme : perfection, réfection (réparation),
suffisant, facteur, affection, désaffection, indéfectible, bénéfice ou
déficience. Notre verbe français « affecter » condense, en
quelque sorte, trois verbes distincts provenant de plusieurs sources latines
mais qui relèvent de cette même parenté : - ad-ficere qui signifie mettre quelqu’un
dans une certaine disposition, le toucher (notamment en mal) et l’épithète
affectus va se spécialiser dans le sens de correspondre au pathos grec ; - affectare qui signifie se mettre à faire, rechercher ; - affactare c’est-à-dire arranger, dont un rejeton en français se
retrouve dans le mot « affèteries ». L’histoire de l’usage du verbe,
en français, le voit prendre progressivement les trois significations
suivantes : 1° rechercher, désirer, tout spécialement
rechercher le pouvoir par ambition (dynamisme du facteur e) ; de là, prendre ostensiblement une forme ou une
manière d’agir, en sous-entendant la double idée du mensonge et du manque de
naturel, voire de la tromperie et de la simulation-dissimulation (dynamisme du facteur hy) ; 2° toucher par impression (où nous frôlons
la question d’un choc potentiellement
traumatique) ; 3° destiner, où se retrouvent le sens
d’arranger, de mettre en état et de préparer en vue d’une finalité, mais aussi
le sens d’instruire et de transmettre un bien ; il sera dès lors question
d’affecter à quelqu’un quelque chose comme un rôle, un droit ou une
rétribution, on pourra aussi affecter ce quelqu'un dans une fonction, en le
désignant pour telle destination. Ne spécifie-t-on pas le vecteur P comme celui
de l’interpellation et de la vocation ? Ainsi « affecter » a-t-il pris, aujourd’hui, trois significations essentielles. 1. Dans la
direction de sens où il est question d’arranger et de disposer, il s’agit d’une
activité (proche du pôle e+)
d’attribution, de consécration, de destination ou d’imputation (au sens où l’on
parle aussi d’imputabilité d’une faute), voire d’une activité de désignation de
quelqu’un pour remplir une fonction ou pour occuper un poste (dont celui de
coupable-fautif désigné). On peut y repérer, du point de vue d’un éventuel
candidat (tel Caïn) à pareille investiture, outre la référence au juge ou censeur censé être l’auteur de la désignation, une aspiration à une
reconnaissance portant sur sa valeur
personnelle ou son mérite propre, de la part de l’instance investie du pouvoir
de décider d’une telle affectation. Ce qui nous fait passer à la seconde
signification. 2. Dans la
direction de sens où il est question de chercher à atteindre, de poursuivre,
d’ambitionner, de chercher à paraître au point de feindre, on voit se dégager
quatre acceptions particulièrement adéquates pour formuler la dynamique du
facteur hy : 2.1.
rechercher et aspirer à, briguer mais avec cette ambition, cette appétence,
cette convoitise (peut-être envieuse ou jalouse), cet arrivisme dans lesquels
se trouve engagée sans doute une prétention idéale d’ordre narcissique (l’ambition et le prix de l’excellence) ; 2.2. avoir
les dispositions voulues pour pouvoir prendre telle ou telle forme (dans cette
tâche d’avoir à se former en vue de quelque destination) ; 2.3. avoir
une prédilection pour, mais excessive jusqu’à prendre, par ostentation ou
singularisation, une manière d’être, de paraître et d’agir qui ne vous est pas
naturelle ; 2.4.
afficher des sentiments que l’on n’éprouve pas ou des qualités que l’on n’a
pas, soit encore exagérer certains sentiments ou certaines qualités au point de
fausser leur authenticité, donc faire semblant ou comme si. Mais quelle
est la provenance de pareille quête, voire le boute-feu de l’ardeur qui l’anime
éventuellement jusqu’à la fureur ? La réponse peut s’entendre dans la
troisième signification, pertinente pour formuler tout à la fois ce qu’il en
est de la position e- et l’effet de choc d’un traumatisme. 3. Dans la
direction de sens indiquée par « ad-fectus », participe passé de
« ad-ficere » (signifiant : pourvoir de, mettre dans tel état,
affaiblir), il est question d’une action exercée sur ce qui en fait l’objet,
auquel une impression est ainsi causée, en particulier sur sa sensibilité.
Affecter prend le sens d’altérer, d’attaquer, d’atteindre, d’impressionner,
d’émouvoir et de toucher, voire même de provoquer des modifications, de quelque
manière que ce soit, chez celui qui subit cette action. Ce qui est propre à l’affect, ce en quoi il diffère par
exemple de l’émotion, c’est qu’il implique un affectataire chargé d’une affectation
propre. Il concerne un intéressé convoqué ou interpellé au titre de sujet destinataire d’une vocation, sujet chez lequel le
mouvement intérieur de l’auto-animation s’apparaît répondre à un appel ou à une
destination, un rôle, une mission. Sujet appelé d’ailleurs, par autre que soi,
à tenir, comme position personnelle, la deuxième : celle du vocatif. Etre
affecté dit la sujétion de ce sujet assujetti à ce dont il est passible et à ce
dont il pâtit, en y éprouvant son être même et la puissance de ce qu’il peut.
Ce qui est sa condition de départ d’où il peut émerger en devenant
l’affectataire chargé de la mission de réserver certaines affectations à ce qui
l’affecte ainsi. L’affect est, selon Freud, l’expression qualitative de la
quantité d’énergie de la pulsion, de l’intensité de l’exigence de travail
réclamée du psychisme. Ainsi le vecteur P a-t-il été mis, par J. Schotte, en rapport
électif avec ce constituant de la pulsion qu’est la poussée elle-même : son poids de charge de mouvance,
d’animation visant la décharge liquidative, son degré de pression et de tension
dynamiques dont la grandeur peut dépasser la mesure des capacités de ce
psychisme à s'acquitter de ces
obligations en devoir desquelles la
pulsion le met ainsi. Soulignons que le terme freudien
« Affektbetrag », que l’on traduit par « quantum
d’affect », a une acception économique et signifie le montant à virer, le
coût à payer ou la dette dont s’acquitter. Toutes ces considérations rejoignent le sens premier du mot instance. Celui-ci provient du verbe
latin « instare » qui signifie se tenir sur et serrer de près,
presser vivement, poursuivre au point de harceler. Le participe présent employé
comme adjectif « instans » signifie présent ou pressant, menaçant,
imminent. Le sens premier du
substantif français est d’exprimer, en en accentuant l’importance quantitative,
l’aspect de pression et d’insistance itérative, voire d’importunité ou
d’inopportunité, en tant que cet aspect peut être celui tant d’un soin
soucieux, d’une sollicitude que d’une sollicitation ou d’une exigence. Cette
exigence a donc quelque chose d’impérieux et de tenace, tel un besoin ou une
tension pulsionnels en tant que tendance élémentaire. Besoin qui assiège avec
toute l’énergie d’un impératif d’urgence, réclamant à cor et à cri, purement et
simplement, satisfaction pleine et entière, sur le champ, dans l’instant même.
C’est selon cette acception primordiale du terme que l’on parle de « faire
instance » auprès de quelqu’un ou de demander « avec instance »,
mais également de « céder (ou non) aux instances » de quelqu’un
d’autre. A partir de là et par la suite,
le mot instance en viendra à exprimer, dans le langage du Droit, le processus
d’ester en justice, d’intenter une action pour que satisfaction s’obtienne via
quelque détour et différé :
entreprise en vue de faire valoir les exigences en cause et d’obtenir
gain de cause, mais en ayant à s’en référer à autre que soi, lequel devra en
décider, et dès lors il s’agit de s’y prendre en respectant des procédures
prédéterminées, conventionnelles, en suivant les mises en forme prévues et
instituées à cet effet. Même en adoptant les « bonnes et dues formes »,
une telle entreprise peut cependant rester « en instance » : en
souffrance tant qu’elle est toujours en cours et donc encore pendante,
c’est-à-dire non encore décidée ni résolue, peut-être faute d’avoir déjà
rencontré l’agence à laquelle il appartient de pouvoir en traiter légitimement.
Et c’est ainsi justement que le terme en vient à nommer, finalement, le corps constitué lui-même auprès duquel instance il y
a et qui détient légitimement un pouvoir reconnu de décision dans l’affaire en
cause, quant au traitement qu’il convient de lui réserver : donc la
juridiction ou le tribunal (pouvant lui-même s’appeler de « première
instance ») qui sont les institutions instaurées à cet effet et investies
de la puissance voulue, habilitées à juger de la recevabilité des plaintes
(plutôt que de les débouter, les refouler) et du sort à leur réserver dans leur
prise en compte. C’est dans ce sens que Freud, dès sa
« Traumdeutung », parlera de l’instance de la censure ainsi que, plus tard, des instances du système de la personnalité (elle-même toujours en
instance) dont celle du surmoi dont
le domaine de compétence concerne électivement le vecteur P. Affect violent, violence de tout
affect Il est couramment question de la violence des affects. Ce qui
ne signifie pas nécessairement que
ceux-ci soient, pour autant, de l’ordre de la violence. Dire qu’il y a une violence intrinsèque à tout affect, de
quelque qualité qu’il soit (érotique ou thanatique, amoureux ou haineux,
soucieux ou agressif, honteux ou orgueilleux, bienveillant ou malveillant,
violateur ou pacifiste, profanateur ou respectueux, cordial ou hostile,
empathique ou égoïste, etc...) – ce en quoi, d’ailleurs, il constitue, par
essence, un potentiel susceptible de devenir traumatogène – c’est dire sa
puissance d’ excéder et de surprendre, d’un surcroît d’excitation, les
possibilités de l’affectataire : celle de l’appareil psychique et du moi
quant à le maîtriser, le dominer, l’assimiler, le métaboliser, lui réserver un
destin gérable. Cette violence dit sa puissance de débordement, de
déchaînement, de déliaison, de déstructuration, d’émancipation vis-à-vis des
institutions et des systèmes de symbolisation et de représentation. Une telle violence de l’affect peut se formuler par cette
expression bien connue « voir rouge »
et ne plus voir que rouge. Celle-ci trouve parfois à se réaliser littéralement
au Rorschach dès qu’intervient, pour la première fois dans les données, de la
couleur appartenant à la gamme chromatique, à savoir lors de la deuxième
planche qui présente de l’encre rouge, contrastant fortement avec le noir et
blanc. On parle alors de choc au rouge dont une autre formulation encore
serait : « n’y voir que du feu » (aveuglement), « prendre
un coup de sang » (attaque, atteinte) ou « se faire du mauvais
sang » (angoisse). Comme s’il y avait là un effet de captation et de
capture qui captive le sujet, effet exercé par le rouge et dont l’affecté se
retrouve captif adhésivement. L’expression « voir rouge » s’emploie
volontiers pour exprimer cette expérience de se retrouver, à un certain moment
du procès de l’affectation, tellement sous le coup et sous la pression de la
tension montante, autant que de la violence de ce qui affecte, au point de ne
plus pouvoir faire autrement que de se conduire à l’image du taureau tellement
excité par le stimulus rouge qu’il en est rendu furieux : adhérer
complètement et céder à son excitation pour foncer tête baissée dans la
réaction qui se trouve impulsée, en lui et de sa part, par ce qui l’émeut.
L’agir se réduit, sans plus d’alternative possible, à l’abréaction engendrée
par l’intensité de cet état affectif auquel l’intéressé assiégé, sous pression,
est tout entier sujet assujetti. Quelqu’un qui raconte : « alors là,
mon sang n’a fait qu’un tour et j’ai vu rouge » situe souvent quelque
chose comme l’instant du basculement, du dépassement d’un seuil, celui du tolérable, passage au-delà
duquel ce quelqu’un n’a plus été, aveuglément, automate sourd à toute voix, que
le jouet de ses passions ou fureurs (J. Starobinski, 1974), dans lesquelles il
n’était plus que complètement absorbé en s’y vouant totalement. Ainsi a-t-il
été, de part en part[16],
traversé, transi, agité et agi par ce que ses affects ont fait de lui, tout
autant qu’il était intégralement identifié, assimilé à ce que ses affects lui
ont fait faire, en l’emportant, corps, âme et biens, dans leur mouvement auquel
il ne pouvait plus qu’adhérer de fond en comble. Et il peut s’agir aussi bien
de transports de colère que d’élans d’énamoration. L’intensité de ce qui
affecte l’emporte sur tout le reste et sur toute autre forme de procès. On peut
reconnaître ici l’alternance d’adhésivité
glyschroïde, entraînant une forme d’immobilisme quelque peu stuporeux ou
déconnecté, et d’éclatement explosif
jusqu’à épuisement des forces et liquidation par décharge : alternance si
typique de l’épileptoïdie[17]
– tout en prenant soin de distinguer cette adhésivité tant de l’adhérence contactuelle, propre à la
position d-, que de l’adhésion au
sens du consentement proprement éthique. De même, la rage, en tant que maladie,
provoque-t-elle, outre la dé-mence (perte du mental), tour à tour des états
d’agitation ou de paralysie. On sait, par ailleurs, que l’expression de cette
adhésivité (fulminante ou jubilatoire) à l’auto-affectation peut très bien se
formuler en empruntant le langage de l’intoxication :
ne dit-on pas être « ivre » de sang et de carnage ou d’orgueil et de
vanité ? Tout autant que l’on peut se retrouver « ivre » de
colère ou de joie, de douleur ou de bonheur, d’épouvante ou d’audace téméraire,
etc. Ex-/in-citation Dans ce qui a été dit jusqu’à présent, que ce soit au sujet
de l’affect ou du traumatisme, plusieurs fois est intervenu le terme
d’excitation. Remarquons tout d’abord que celui d’incitation aurait convenu
tout autant ; par ailleurs, il est quasi-synonyme d’impulsion. A travers
les deux préfixes qui diffèrent, on peut entendre le double à partir de la genèse
de la mise en mouvement visée, lequel
mouvement pousse de l’en-dedans vers son extériorisation, l’effet de
l’impression-effraction exogène est de susciter ces poussées actives
endogènement. Mais le substantif « citation » s’avère
particulièrement significatif et ne dit pas n’importe quelle motion. La racine
indo-européenne du verbe « citer » est la même que celle qui a donné,
en grec, kinein voulant dire mouvoir,
mettre en mouvement, ce que l’on retrouve par exemple dans
« kinesthésie ». « Citer »
prend trois sens, une fois de plus particulièrement parlants dans le contexte
du vecteur qui nous occupe : 1° sommer
de comparaître ; 2° rapporter
un texte à l’appui de ce que l’on avance, alléguer : n’est-ce pas le rôle
de Moïse, homme de Dieu, rapporteur de la parole de Dieu, lui dont la parole
propre est entravée et qui ne parlera que par citation du message divin, tout
autant qu’il transmettra des lois que Dieu lui-même a écrites en les inscrivant
dans le roc des tables dont Moïse n’est que le transporteur ; 3° désigner
qui est digne d’attention, en reconnaissant sa valeur ou ses mérites. Ainsi pouvons-nous entendre cette citation, commune aux excitations et incitations, telle une
sommation à comparaître adressée à qui doit jouer un certain rôle dans un
procès – tout comme, disions-nous, l’instance des exigences nécessite que
celles-ci prennent les formes d’une procédure en bonne et due forme et que soit
institué un corps constitué aux fins d’en traiter. Ainsi est-ce le système du
moi, auquel appartient notamment l’instance surmoïque, qui se trouve appelé à
s’instaurer, cité à apparaître, tout
comme le moi est sommé de comparaître
par le sur-moi et devant celui-ci. Aussi, l’acte de se faire disparaître (par suicide par exemple)
peut-il également prendre le sens d’une révolte contre pareille citation :
opposer une fin de non recevoir à la vocation, se refuser à l’affectation, se
soustraire à tout appel par l’Autre. La citation désigne l’affectataire et
repère le sujet en tant que chargé de l’affectation. Ne pourrait-on encore ajouter ceci, en
anticipant quelque peu sur ce que je reprendrai très bientôt : dans sa
référence à Dieu, ce que brigue Caïn serait quelque citation au tableau
d’honneur divin qui consacrerait combien sa valeur personnelle mérite d’être
distinguée de celle de son frère Abel, vu la qualité supérieure de l’offrande
dont il s’est fendu. La violence telle que nous l’envisageons ici apparaît
également comme une propriété du désir
laissé à lui-même et c’est ce que viennent frapper d’interdit les prohibitions
fondatrices dont Freud dit qu’elles portent sur « les tentations les plus
anciennes et les plus fortes des hommes », susceptibles donc de faire
d’eux des criminels, à savoir l’interdit de l’inceste et du meurtre. Si
l’inceste s’avère une tentation essentiellement en jeu dans les vecteurs
périphériques C et S, avec le passage au vecteur P, c’est essentiellement de la
tentation de l’homicide (parricide, fratricide et suicide liés) dont il devient
question, tandis que, en position d’autre de référence, le père se substitue à
la mère. Mais si nous passons, comme pour l’affect, du désir d’inceste et du
désir de meurtre à la violence de tout
désir, c’est afin de souligner ce que le désir a de foncièrement
« incestueux » et « meurtrier » à la fois. En effet, le
désir incestueux concerne un certain mode de réalisation de l’appétence
érotique et de l’appétit de plaisir, en même temps qu’un certain mode de
jouissance pleine et entière de ce qui donne du plaisir et procure la
satisfaction convoitée. Le désir parricide concerne un certain mode de
suppression ou d’abolition de ce qui, et de tout qui, interfère dans ce que le
désirant souhaite se procurer ou de ce qui entre en contradiction avec ses
aspirations ou tentations. D’une part, le désir d’inceste peut s’entendre comme
désir de posséder complètement et entièrement l’autre dont je tiens ma
jouissance, désir de maîtriser intégralement
et souverainement la source de mes
satisfactions ou gratifications, d’avoir absolument
en mon pouvoir l’assouvissement de mes tendances sans que ne puisse entrer en
ligne de compte rien d’autre que cet accomplissement (inceste viendrait de
« in-castus » de carere : ne pas être manquant). D’autre part,
le désir de meurtre (du père paradigmatiquement) en est l’autre versant en ce
qu’il vise à détruire tout (ce) qui peut résister, empêcher ou limiter mon
assouvissement intégral. C’est le désir d’éliminer toute adversité en contradiction par rapport à mon comblement, ainsi que
tout adversaire à ma satiété. Les
deux désirs ont en commun ce désir que mon désir soit tout puissant :
qu’il lui suffise d’exister, d’être là pour trouver à se satisfaire tant intégralement que totalitairement, c’est-à-dire incestueusement
et destructivement de toute altérité
ou altération telle que la
réalisation puisse différer du voeu
ou de l’idéal dont rêve le désir. La violence de tout désir est de se désirer
tout puissant, en quoi il serait donc foncièrement incestueux et meurtrier. Le drame de Caïn Le temps est venu de réévoquer la figure de Caïn, au risque
de la « psychologiser ». Le dépit (où se mêlent déception – peut-être
amoureuse ?[18] –
d’une non reconnaissance personnelle et blessure narcissique) et le sentiment
d’injustice subie, lesquels transforment sa jalousie envers le rival préféré en
vengeance fratricide, peuvent se ressaisir tel l’indice d’une méprise, faute que se soit discernée la
loi propre à ce vecteur de celle qui
régissait le vecteur sexuel. Si la position h- peut se formuler par l’action de donner (J. Kinable, 1995), la
réaction e- apparaît comme l’effet
d’un don mal accueilli, puisque le cadeau, dont il s’était fendu, essuie une
fin de non recevoir et de non agrément : ce don est méprisé par celui à
qui le sacrifice en avait été offert. Effet de méprise dans la mesure où, sans
doute, la réponse attendue se représentait sous les espèces d’un contre-don,
gage de reconnaissance de cette valorisation supérieure à celle de son frère
que son offrande plus prestigieuse ou plus précieuse (prix de son travail de la
terre) était censée (en avoir ainsi présumé serait-il présomptueux ?) lui
valoir : lui gagner ou lui mériter. Comme si Caïn abordait le rapport au
Dieu-Père selon cette loi du change et de l’échange propre au vecteur S. Comme
si la valeur de la personne pouvait
se négocier en un échange marchand où dominent le calcul d’intérêt et
l’utilitarisme[19].
Comme s’il pouvait traiter à égalité (celle d’un partenariat) avec l’instance supérieure-dominante du censeur. Comme
si était nul et non avenu ce dit « trauma de la différence des
générations » laquelle est génératrice d’une hiérarchisation de positions corrélatives mais dissymétriques entre
sujets, positions qui, comparativement les unes aux autres, apparaissent
articuler des relations de domination et de subordination (ainsi qu’il en va
également entre le si bien nommé surmoi
et le moi) lesquelles sont facteurs de complexes d’infériorité et de
supériorité[20].
Différence telle que l’enfant se doit à
ses parents et leur est redevable, tout en se devant à d’autres obligations
encore à l’égard des pairs de sa propre génération (être le « gardien de
son frère » ?). Notons au
passage que le terme allemand pour dire culpabilité « Schuld » a le
double sens de faute, offense et de dette, créance, obligation, alors que la
« culpa » latine n’exprime que la faute à imputer. Le Censeur, à
l’origine c’est-à-dire dans l’antiquité romaine, est un magistrat chargé
d’établir le cens et qui avait le droit de contrôler les moeurs des citoyens.
Censure signifiait alors sa dignité et sa charge. Le cens était le recensement consistant à dénombrer les citoyens (à
comptabiliser qui entre en ligne de compte et compte pour un, mais aussi sur
qui l’on peut compter) et à évaluer leur fortune afin de répartir l’impôt et de
fixer le montant dont chacun était redevable en sa qualité et au titre de
citoyen méritant pareille dignité. Il n’est donc nullement question de justice
distributive qui accorderait à chacun la part qui lui revient comme son dû
(dans l’application d’une loi de partage et d’appartenance). Mais en sens
inverse, il s’agit d’une juste appréciation de la dette de chacun : ce qu’il a comme obligation à l’égard de la solidarité ou du bien commun, compte
tenu des biens dont il dispose. Au Moyen- Âge, le cens signifie également la
redevance que le possesseur d’une terre doit au seigneur du fief. Finalement,
dans certains systèmes électoraux, le cens signifie la quotité d’imposition
donnant droit à la dignité d’électeur ou d’éligible, ayant donc droit de parole
et voix au chapitre dans l’exercice du pouvoir politique. Selon M. Dumézil
(cité par E. Benvéniste, 1969 b, p. 145) le sens premier de la racine
indo-européenne exprime la fonction qui consiste à « situer (un homme ou
un acte ou une opinion etc) à sa juste place hiérarchique, avec toutes les
conséquences pratiques de cette situation, et cela par une juste estimation
publique, par un éloge ou un blâme solennel ». Et E. Benvéniste (1969 b,
p. 148) explicite que : « le censor
prononce la situation de chacun et son rang dans la société : c’est là le census, estimation hiérarchisante des
conditions et des fortunes ; plus généralement, censeo, c’est “estimer” toutes choses à leur juste valeur,
donc “apprécier”, aux deux sens du mot. Pour le faire, il faut l’autorité
requise ». Caïn ne se révolte-t-il pas contre la place hiérarchique qui
lui est réservée au titre d’affectation
et d’accréditation : tout à un
sentiment d’injustice subie, ne s’insurge-t-il pas contre l’inéquitable
appréciation de sa valeur, relativement à celle accordée à son frère ? Ou
encore : s’est-il senti trahi
dans la confiance placée en la
justice distributive ou en la justesse de jugement du censeur ? La
trahison est le contraire de la fidélité. C’est une figure de l’abandon : abandonner quelqu’un à
qui l’on doit fidélité ou cesser cette fidélité due à quelqu’un du fait de lui
être lié (ob-ligare) par une parole donnée, par une foi jurée ou par une solidarité entre alliés. On peut trahir sa
promesse à l’égard d’un autre, on peut trahir la confiance de l’autre en soi.
Trahison dont J. Genet faisait l’éloge en même temps que celle du mensonge. Ainsi voyons-nous progressivement émerger, au seuil de passage et de rupture entre
vecteurs S et P ainsi que l’illustre la figure de Caïn, quels enjeux viennent se nouer en un même drame critique, propre à ce vecteur
des affects. Esquissons-en une articulation, plutôt sous forme d’indications ou
de propositions pour de futurs développements. Ces enjeux interdépendants, j’en
retiendrai (provisoirement ?) quatre que je formulerais ainsi : la
question de la valeur personnelle, celle du crédit de la parole, celle de la
garantie de fiabilité et celle de la mort dont ont peut être l’auteur. 1° La
reconnaissance, par autre que soi, de la valeur
personnelle du sujet en tant que sujet. Il ne s’agit plus ici de cette valeur inconditionnelle dont
on bénéficie du fait même de l’amour maternel/parental mais dont on est privé
en cas d’abandonnisme (J. Kinable, 1993). Ce qui est en cause, c’est la valeur
du sujet en tant qu’être de parole (n’invoque-t-on pas une « parole
d’honneur » ?), valeur consacrée par le fait d’être présumé (ou
censé) digne de confiance, méritant
le crédit que les autres lui portent
dans la mesure où il est reconnu en tant qu’ « homme de parole » c’est-à-dire capable de tenir au futur des engagements, bien que ceux-ci limitent
désormais sa liberté de par ces
obligations à assurer et à assumer (plutôt que les renier) auxquelles lie
l’engagement pris. Celui-ci transcende les mobiles, motifs, raisons, intérêts,
utilités... du moment présent où il se prend[21]. 2° La confiance et la fidélité interpersonnelles entre pairs, frères ou solidaires. C’est la question du crédit
à s’accorder mutuellement, malgré la hantise de la trahison et le doute sur la
bonne foi ou sur la capacité à tenir dans la durée à venir. Les travaux d’E.
Benvéniste ont montré que la foi dont se créditer entre humains passe par celle
misée sur les dieux. Etymologiquement, indique-t-il, croire signifie se fier
en, « poser en quelqu’un la * KRED (d’où résulte la confiance) » – la
racine * KRED signifiant quelque chose comme une « force magique »
(1969 a, p. 172). S’il y a l’idée d’une offrande, « c’est pour retrouver
le bénéfice de ce qu’on a engagé qu’on accomplit cette dévotion » (1969 a,
p. 177). Et Benveniste de poser : « *KRED serait une sorte de
“gage” , d’ “enjeu” ; quelque chose de matériel mais qui
engage aussi le sentiment personnel, une notion investie d’une force magique
appartenant à tout homme et qu’on place en un être supérieur. Il n’y a pas
d’espoir de mieux définir ce terme mais nous pouvons au moins restituer le
contexte où est née cette relation qui s'établit d’abord entre les hommes et
les dieux, pour se réaliser ensuite entre les hommes » (1969 a, p. 179).
Même tension donc entre logique marchande et ce qui lui échappe ou la
transcende. 3° La
référence à une instance supérieure au titre de garant (des serments, promesses, obligations, engagements... entre
pairs qui s’allient). Le drame de Caïn ne paraît-il pas causé par l’effet
traumatogène que ce garant puisse sembler faire défaut ou être en faute,
c’est-à-dire tenir cette fonction tout en n’étant lui-même engagé à rien ni par
rien[22] :
en restant souverainement et absolument libre de sa décision (comme celle d’un
non agrément et d’une non accréditation, dont les raisons restent énigmatiques[23])
liberté nullement engagée par les sacrifices qui lui avaient été offerts. Que
la garantie puisse venir à manquer,
que le garant semble défaillir à l’assurer, du moins selon les attentes,
comment faire son deuil d’une telle faillibilité de ce qui devrait être fiable
assurément ; en quoi pourrait bien consister la substitution, la
métamorphose de ce qui peut être attendu, seule voie de renoncement selon
Freud ? Non pas le « tout est permis » d’Aliocha Karamazov, mais
bien « plus rien n’est garanti » ! Qui, dès lors, serait encore
digne de foi ? Et la trahison, la non fiabilité seraient soupçonnables
chez tous... Non plus « qui “mérite” de compter pour un » mais
« sur qui pouvoir encore compter ? ». 4° La fonction de la mort et du meurtre. Non pas la mort par passivation absolue de soi, réduit à
l’état de totale impuissance, ainsi que certaines épreuves traumatiques
(d’accident ou d’agression) viennent en imposer une expérience certaine. Non
pas la néantisation d’une poussée à se mourir pour n’être pas né. Non pas le
meurtre par adhésivité, ou abandon aveugle et sourd, à la violence destructrice
et mortifère d’un pulsionnel déchaîné, voire à la toute puissance du désir. Pas
davantage la nécessaire élimination de tout autre pour que le moi puisse en
ressortir confirmé narcissiquement en lui-même, ce en quoi A. Vergote (1994)
identifie la dimension paranoïde du complexe de Caïn. Mais bien plutôt la mort
dont le sujet administre la preuve qu’il a conquis la capacité soit de l’encourir et de la risquer, soit de l’infliger :
mort qui porte alors témoignage et devient un gage de la valeur et de la
dignité personnelles d’un tel sujet, dans la mesure où il serait capable de
tuer ou de se faire tuer. De nombreux travaux d’anthropologie seraient à reprendre ici
pour éclairer une telle thématique. J’en resterai à l’évocation de deux
exemples. D’un côté, D. Le Breton a étudié ce phénomène qu’il appelle
« les passions du risque » telles que s’affronter, de soi-même, à la
mort et en réchapper, loin de la culpabilité bien connue d’autres rescapés,
engendrent le sentiment que son existence prend de la valeur. Il écrit (1991,
p. 11) : « un acteur demande à la mort par l’intermédiaire de la
prise de risque si son existence a encore un prix. Survivre a valeur de
garantie et suscite une intensité d’être provisoire ou durable ». Ou
encore, il déclare (1992, p. 55) : « Il y a, chez de nombreux jeunes,
la même nécessité intérieure de tester leur relation à la mort pour savoir si
vivre a une signification et une valeur ». Tout se passerait-il donc comme
si la mort se retrouvait en lieu et place de cette instance transcendantale à
laquelle fait appel le procès de la valorisation de soi, faute que le
symbolique paraisse encore fondé à en assumer la fonction ? D’un autre côté, Chr. Geffray (2001) observe, chez certains
peuples, combien se montrer capable de sacrifier tout bien, dont celui suprême
de sa propre vie, est censé apporter le témoignage de la fiabilité de sa
parole, de cette capacité à tenir ses engagements vu la liberté souveraine
conquise sur la pure logique de son propre intérêt. BIBLIOGRAPHIE ANZIEU, D. (1966-67), La signification particulière de
chaque planche du test de Rorschach, in Revue
de Psychologie et des Sciences de l’Education, Vol 2, n° 4, Louvain, pp.
309-325. ANZIEU, D. (1985), Le
Moi-peau, Paris, Dunod. ANDIEU, D. (1994), Le
Penser. Du Moi-peau au Moi-pensant, Paris, Dunod. ANZIEU, D. (1996), Créer
Détruire, Paris, Dunod. BENVENISTE, E. (1969 a), Le vocabulaire des institutions indo-européennes : 1. économie,
parenté, société, Paris, Ed. de
Minuit. BENVENISTE, E. (1969 b), Le vocabulaire des institutions indo-européennes : 2. pouvoir,
droit, religion, Paris, Ed. de
Minuit. CAILLÉ, A. (2000), Anthropologie
du don. Le tiers paradigme, Paris, Desclée De Brouwer. CHABERT, C. (1983), Le Rorschach en clinique adulte. Interprétation psychanalytique,
Paris, Dunod. CHABERT, C. (1987), La psychopathologie à l’épreuve du Rorschach, Paris, Dunod. CHABERT, C. (1994), Les approches structurales, in
WIDLÖCHER, D. (sous la direction de), Traité
de psychopathologie, Paris, P.U.F. pp. 105-157. CHABERT, C. (1998), Psychanalyse et méthodes projectives, Paris, Dunod. DÉRI, S. (1998), Introduction
au test de SZONDI, 2è édit., Bruxelles, De Boeck Université, Bibliothèque
de pathoanalyse. FREUD, S. (1929), Das
Unhehagen in der Kultur, (1971) Malaise
dans la civilisation, trad. par Ch. et J. ODIER, Paris, P.U.F. GEFFRAY, Chr. (2001), Trésors : anthropologie analytique de la valeur, Strasbourg,
Arcanes. HADDAD, A. et G. (1995), Freud en Italie, Paris, Albin Michel. HAXHE, S. (2001), L’impact de l’écart d’âge sur le
devenir des membres d’une fratrie, in Cahiers
du CEP n° 8, Plainevaux, pp. 188-202. KINABLE, J. (1990), Au contact de ... : sens en
émoi et aube du moi, in SCHOTTE, J. (éd) Le
contact, Bruxelles, De Boeck
Université, Bibliothèque de pathoanalyse, pp. 25-46. KINABLE, J. (1991), Sentir et érogenèse : du
contact à l’éveil sexuel, in FEDIDA, P. et SCHOTTE, J. (éd), Psychiatrie et existence, Grenoble, J.
Millon, pp. 291-319. KINABLE, J.
(1993), Psychopathie et perversion, in
Cahiers du CEP n° 3 : Colloque du Centenaire de la naissance de Léopold
Szondi, Budapest 14 - 17 avril 1993, Plainevaux, pp. 45-71. KINABLE, J. (1995), La partition szondienne du
sexuel : change et échange, in Cahiers
du CEP n° 5 : Versions du
sexuel, Plainevaux, pp. 14-31. KINABLE, J. (2000), La psychopathie au « soleil
noir » de la mélancolie, in WEIL, D. (Ed.), Mélancolie : entre Souffrance et Culture, Strasbourg, Presses
Universitaires de Strasbourg, pp. 75-93. LE BRETON, D. (1991), Passions du risque, Paris, Métailié. Questions à ... David LE BRETON : Le risque, une
aventure existentielle, Le journal des
psychologues, Février 1992, n° 94, pp. 55-56. LEGENDRE, P. (1974), L’amour du censeur, Paris, Seuil. LEKEUCHE, Ph. (1994), Karamazov et circuit P de
Schotte, in Cahiers du CEP n° 4 :
Paroxysmalités, Plainevaux, pp.
11-37. MALDINEY, H. (1991), Penser l’homme et la folie à la lumière de l’analyse existentielle et
de l’analyse du destin, Grenoble,
J. Millon. MALDINEY, H. (1994), Le paroxysmal dans l’art, in Cahiers du CEP n° 4 : Paroxysmalités,
Plainevaux, pp. 39-72. MALDINEY, H. (2000), Ouvrir le rien. L’art nu, Fougères, Encre marine. MÉLON, J. et LEKEUCHE, Ph. (1990), Dialectique des pulsions, 3è éd.,
Bruxelles, De Boeck Université, Bibliothèque de pathoanalyse. MUCCHIELLI, R. (1968), La dynamique du Rorschach, Paris, P.U.F. PICOCHE, J. (1979), Dictionnaire étymologique du Français, Paris, Les usuels du Robert. PLUYGERS, Cl. (1994), Le dédoublement paroxysmal comme
séparation du monde dans « L’Idiot » de Dostoïevski, in Cahiers du CEP n° 4 : Paroxysmalités,
Plainevaux, pp. 83-88. REY, A. (sous la direction de) (1995), Dictionnaire historique de la langue
française, 2 vol., Paris, Le Robert. ROBERT, P. (1972), Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 7 vol., Paris, Le
Robert. ROISIN, J. (1995), Considérations sur le traumatisme,
in La Revue Nouvelle, Tome CI, n° 3,
Bruxelles, pp. 68-77. SCHOTTE, J. (1990), Szondi avec Freud : sur la voie d’une psychiatrie pulsionnelle,
Bruxelles, De Boeck Université, Bibliothèque de pathoanalyse. SCHOTTE, J. (1999), Des fondements de l’anthropopsychiatrie,
in Transhumances I : Construction de savoirs en situations
cliniques : dialogues sur le langage en acte, Namur, Presses
universitaires de Namur, pp. 121-140. STAROBINSKI, J. (1974), Trois fureurs, Paris, Gallimard. SZONDI, L. (1971), L’homme Moïse à la lumière de
l’analyse du destin, in Revue de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Vol. 6, n° 4, Louvain, Nauwelaerts, pp. 428-445. TISSERON, S. (1993), Tintin et le secret d’Hergé, Paris, Hors collection/Presses de la
Cité. TISSERON, S. (1995), Psychanalyse de l’image. De l’imago aux images virtuelles, Paris,
Dunod. VAN REETH, Cl. (1971),
L’affect dans le système de Szondi, in Revue
de Psychologie et des Sciences
de l’Education, Vol. 6, n° 4, Louvain, Nauwelaerts, pp. 491-509. VERGOTE, A. (1971), Complexe d’Oedipe et complexe de
Caïn. Ethique, Psychanalyse et Analyse du destin, in Revue de Psychologie et des Sciences de l’Education, Vol. 6, n° 4,
Louvain, Nauwelaerts, pp. 446-455. VERGOTE, A. (1994), La violence paranoïde du Caïn et
son humanisation, in Cahiers du CEP n° 4 : Paroxysmalités,
Plainevaux, pp. 116-124. [1] Cette formule a également inspiré P. Derleyn dans sa contribution au présent volume sous le titre "Dialectique de l'avant et de l'arrière-plan". [2] C’est ce qu’indique le titre d’un ouvrage de C. Chabert « La psychopathologie à l’épreuve du Rorschach » que l’on pourrait compléter en renversant la proposition : le Rorschach à l’épreuve de la psychopathologie. [3] Dans la suite du texte, l’usage du pronom « nous » marquera la référence à des recherches menées en concertation par divers membres de cette école. [4] Une illustration démonstrative de pareille démarche est fournie par l’exposé de M. Ledoux « Constellations sociales, constellations pulsionnelles » repris dans ce même ouvrage. [5] Un modèle de recherche rencontrant ce problème est proposé par la magistrale étude de Ph. Lekeuche « Un éclairage szondien de la schizophrénie » faisant partie de la présente publication. [6] Les travaux de J. Roisin s’en font l’écho – cfr. bibliographie. [7] Cfr., dans la bibliographie, J. Kinable (1990, 1991, 1993, 1995, 2000). [8] Cfr., dans la bibliographie, H. Maldiney (1991). [9] On pourrait consulter, à ce propos, D. Anzieu (1966), C. Chabert (1983) ou R. Mucchielli (1968). [10] Ces propositions de grille d’analyse rencontrent également les principes de lecture élaborés par S. Tisseron (1993, 1995) dans son étude de diverses oeuvres. [11] Cfr. D. Anzieu (1985, 1994, 1996). [12] On pourrait reprendre également ici les considérations que A. et G. Haddad (1995) consacrent à l’ « Homo viator ». [13] Ceci me paraît évoquer également cette si éclairante proposition de M. Badanaï qu’il y aurait lieu de concevoir chacune des tendances pulsionnelles en tant que ressort et contenus (primaire et secondaire) en rapport à une valeur spécifique. Cfr. son texte dans ce présent volume « Scheler et Szondi : pour une mise en “valeur(s)” du système szondien ». [14] Cfr. H. Maldiney (1994). [15] Toutes les études étymologiques et lexicologiques de ce texte sont empruntées aux dictionnaires « Le Robert ». [16] On peut y reconnaître ce même axe vertical que celui du « se fendre ». [17] H. Maldiney (1994, 2000) en étudie les manifestations dans diverses oeuvres d’art. [18] Cfr. P. Legendre (1974). [19] Cfr. A. Caillé (2000). [20] D’intéressantes analyses des rivalités fraternelles sont proposées par S. Haxhe (2001). [21] La sincérité du sujet n’est pas nécessairement en cause. Ainsi qu’en témoigne particulièrement bien la « parole de l’alcoolique », l’énoncé du dessein de « ne plus boire » peut correspondre à la formulation d’un voeu dont l’accomplissement coïncide avec sa profération, sans que n’entre en ligne de compte le « fait » que sa réalisation reste à effectuer pour qu’il en advienne ainsi qu’il est prétendu (« prendre ses désirs pour des réalités »). Ce serait se méprendre d’y entendre quelqu’engagement ! [22] La Genèse n’en est pas encore à l’Alliance qui s’inscrira rituellement par un signe dans la chair : c’est par une autre marque que Dieu protégera Caïn de toute vindicte vengeresse entre humains. [23] Yahvé n’évoque, après le non agrément, que les dispositions dans lesquelles Caïn se retrouve : nous avons vu que celles-ci peuvent être synonymes d’affectation. |
 |
 |
© 1996-2002 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev