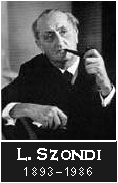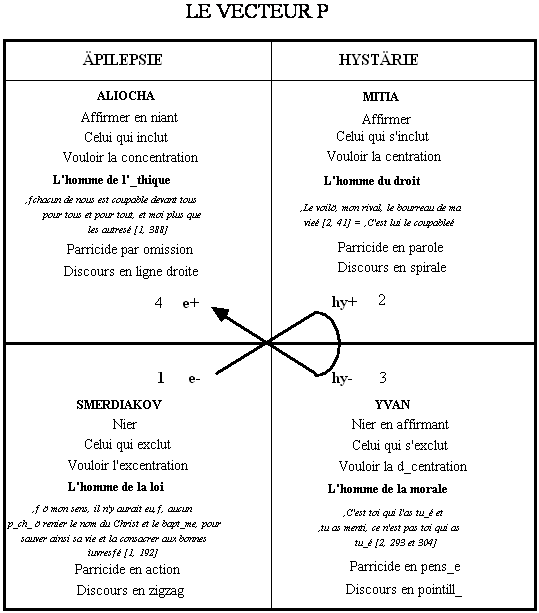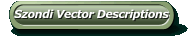
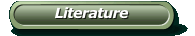







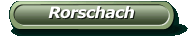

|
||||
 |
 |
|||
|
KARAMAZOV ET CIRCUIT P DE SCHOTTE [1]. - UNE ÉTUDE SZONDIENNE DU CHEF-D’ŒUVRE DE DOSTOIEVSKI -
Par Philippe Lekeuche
En 1975, Jacques Schotte “découvrit” les circuits pulsionnels tels qu’ils fonctionnent dans le “Triebbild” de Léopold Szondi. Dans cet ensemble de quatre vecteurs, le vecteur Paroxysmal ou vecteur des affects articule la problématique hystéro-épileptique telle qu’elle recouvre, au plan anthropologico-clinique ainsi que Freud et Szondi ont pu le montrer, la question soulevée par le sujet dans le complexe d’Oedipe en tant qu’il conjoint à la fois le désir de la mère et le désir du parricide [2]. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu tenter, dans les pages qui suivent, une lecture szondienne de “Les frères Karamazov” de Dostoïevski. Le dernier roman du grand écrivain russe raconte en effet l’histoire d’un parricide et il nous importait de savoir si le circuit paroxysmal pouvait éclairer la structure du roman et si l’oeuvre littéraire pouvait en retour adéquatement renouveler la sphère conceptuelle du vecteur P. Mais avant de la commenter plus avant, nous présentons l’esquisse de notre lecture szondienne des frères Karamazov dans le tableau suivant:
Smerdiakov forme le radical des frères Karamazov (e-) : il est présent au fond de ses trois frères. Il est le négateur par excellence : il apprend au petit Illioucha à tuer le chien Scarabée; l’enfant en mourra de chagrin. Smerdiakov n’est pas seulement parri-cide, sui-cide, il est aussi infanti-cide : il s’attaque au fondement du Monde (la paternité) et au fond du Monde, c’est-à-dire à l’enfance, la réserve du Monde, à ce qui, dans notre culpabilité, nous reste d’innocence. Smerdiakov tue l’innocence du petit Illioucha et le culpabilise à mort. Smerdiakov hait tout, y compris lui-même.
Sa haine prend le masque de l’indifférence : il ne s’intéresse à rien, tout le dégoûte (bien qu’il soit un excellent cuisinier). Taiseux, insociable, arrogant, il méprise tout le monde. Le propre de la haine est de faire table rase de toutes les valeurs. Smerdiakov est l’homme de l’“à quoi bon ?”, du “tout m’est égal”. Dans le livre III, le chapitre 7 intitulé “Une controverse” nous montre un Smerdiakov théoricien : pour lui, il n’existe rien de définitif, rien de fondé, tout se vaut, tout est dérisoire. La thèse qu’il défend est la suivante : qu’un chrétien souffre le martyre ou renie le Christ pour sauver sa vie, pour un chrétien mis en demeure de choisir, c’est du pareil au même. Tout est égal.
Berdiaeff écrit que Smerdiakov est une “caricature informe et lamentable” de l’âme russe. Mais qu’est-ce qui forme le fond de l’âme russe ? Quelle est la géographie de cette âme si semblable à la géographie de la terre russe ? Citons encore Berdiaeff : “L’autodestruction et l’autoconsomption sont en Russie des traits nationaux” [3, 20]; et reprenant Dostoïevski : «“Le nihilisme est apparu chez nous, écrit Dostoïevski dans son carnet, parce que nous sommes tous nihilistes”. C’est ce nihilisme qu’il étudie jusqu’au fond, nihilisme qui n’est, encore une fois, qu’un apocalyptisme renversé”» [p. 18].
Revenons à la géographie : la terre russe est plaine, toundra, steppe, que rien, en apparence, ne vient limiter. “Le défaut de forme” - de leur terre, de leur âme - abolit chez les russes tout véritable instinct de conservation : “ils se détruisent, se consument eux-mêmes pour un rien, il disparaissent dans l’espace” [p. 203]. En cette terre russe, en cette âme russe, tout est égal, tout est suicidaire; tel est son fond, tel est Smerdiakov, sa caricature informe. Smerdiakov nie qu’il y ait quelque chose à nier, c’est pourquoi j’ai dit qu’il était le négateur par excellence. C’est à peine si le père Karamazov existe pour lui : il le sert, il lui est fidèle, il le protège et en même temps il le tue pour faire plaisir à Yvan (et donc, du même coup, perdre ce dernier). Smerdiakov ne vit pas dans l’indifférence mais dans l’indifférenciation haineuse primordiale dans laquelle une chose égale l’autre, une chose détruit l’autre, etc... On retrouve cette indifférenciation haineuse primordiale dans la crise d’épilepsie et le suicide (cf. l’analyse de Freud : “Dostoïevski et le parricide”) : tuer l’autre revient à se tuer soi-même, tuer soi-même revient à tuer l’autre. Le suicidaire s’envoie au diable avec le monde entier.
Mitia affirme que ce Smerdiakov nie : il affirme la nécessité de nier, de s’opposer aux prétentions de son père à l’égard de Grouchegnka. Quel est pour lui le statut de ce père ? Ce père est un rival, un faux-frère, un “double”. La deuxième position de notre circuit est celle d’un sujet narcissique, au sens du stade du miroir : le rival, sa propre image, est à la fois haï et adulé. Lorsque cette position s’accentue, il se produit un dédoublement tel celui qui suit la régression d’Yvan Karamazov après ses entretiens avec Smerdiakov, à l’hôpital. Lorsque cette position n’est pas accentuée, elle est celle de la rivalité fraternelle, narcissique, en miroir. C’est le cas entre Mitia et son père. Le roman ne laisse subsister aucun doute sur la nature des relations entre les deux hommes [3] :
a) au début du roman, la famille Karamazov et l’une ou l’autre de ses relations sont réunies dans la cellule du starets Zossime; Mitia et son père font une scène. Chacun exprime le désir de tuer l’autre dans un rapport duel : “- En duel ! glapit de nouveau le vieux, haletant et bavant à chaque mot.” “- Pourquoi un tel homme existe-t-il ? rugit sourdement Dmitri Fiodorovitch, (...)” [1, 123] Tous les deux sont en rivalité pour la possession de Grouchegnka.
b) par rapport à la question de la limite à franchir ou à ne pas franchir, la position de Mitia est identique à celle de son père; Rakitine dit à Aliocha, en parlant de Dmitri :
“ Chez ces gens très honnêtes, mais sensuels, il y a une ligne qu’il ne faut pas franchir. Autrement, il frappera même son père avec un couteau.” [1, 130]
Quant au père Karamazov, il nous est dit de lui qu’“il ne dépassait jamais certains limites, ce qui ne laissait pas de le surprendre.” [1, 140]. Mais une fois la limite franchie, plus rien ne l’arrête :
“Puisque j’ai commencé, il faut aller jusqu’au bout” [1, 14]
“Et bien qu’il sût parfaitement que tout ce qu’il dirait ne ferait qu’aggraver cette absurdité, il ne put se contenir et glissa comme sur une pente.” [1, 143].
Dès qu’une certaine limite est franchie, plus rien n’arrête Mitia et son père.
c) La perte de la maîtrise, l’enfoncement, le glissement sur une pente, voilà autant de traits qui révèlent le masochisme d’une telle position. Le père Karamazov déclare au starets :
“Oui, oui, j’ai pris plaisir toute ma vie aux offenses, pour l’esthétique, car être offensé, non seulement, ça fait plaisir, mais parfois c’est beau !” [1, 84]
ou encore : “A maintes reprises, au cours de sa carrière, Fiodor Pavlovitch risqua d’être battu, et même cruellement;” [1, 148]
Quant à Mitia, parlant de lui-même au passé, il dit :
“J’étais alors un vrai casse-cou” [1, 171]
et présentement :
“Quand je roule dans l’abîme, c’est tout droit, la tête la première; il me plaît même de tomber ainsi, je vois de la beauté dans cette chute. Et du sein de la honte j’entonne un hymne.” [1, 166]
d) Un quatrième trait semble trahir le rapport en miroir entre Mitia et son père. Mitia déclare à Aliocha :
“Peut-être le tuerai-je, peut-être ne le tuerai-je pas. Je crains de ne pouvoir supporter son visage à ce moment-là. Je hais sa pomme d’Adam, son nez, ses yeux, son sourire impudent. Il me dégoûte. Voilà ce qui m’effraie, je ne pourrai pas me contenir.” [1, 185]
Mitia et son père se reflètent l’un dans l’autre et se détestent mutuellement. Ils s’observent en détail, s’épient, sont voyeurs l’un de l’autre (la femme Grouchegnka étant toujours présente à l’horizon). La rivalité narcissique en miroir s’inscrit dans une structure triadique impliquant à l’arrière-fond la présence de l’objet d’amour. L’ambiguïté d’une telle structure est telle que l’obstacle tend toujours à devenir objet alors que l’objet constitue déjà une manière d’obstacle. Le rapport à l’objet est secondaire, ce qui prime, c’est le rapport au rival. L’objet est contaminé, il est lui-même objet de rivalité : il existe un combat entre Mitia et Grouchegnka, entre le père Karamazov et Grouchegnka : pour sauvegarder son narcissisme, chacun blesse l’autre. Il s’agit du narcissisme au sens imaginaire du terme :
“je veux me sentir complet ou complète, intègre, entier ou entière”
Et effectivement, tant Mitia que son père veulent apparaître comme des individus entiers. A propos du désir parricide de Mitia, le séminariste Rakitine déclare à Aliocha :
“Je n’aurais rien vu, si je n’avais compris aujourd’hui Dmitri Fiodorovitch, ton frère, d’un seul coup et en entier, tel qu’il est, d’après une certaine ligne.” [1, 130]
e) Je signalerai enfin brièvement que Dostoïevski marque explicitement, par une série de traits qu’il leur confère, la forte ressemblance entre Mitia et Fiodor : tous les deux sont qualifiés de “fêtards” [1, 45-46]; ce sont des “voluptueux”, “avec des passions vives” [id.]; tous les deux fréquentent assidûment les cabarets, faisant scandale, exhibant leurs passions et leur dépit (Fiodor : [1, 4]; Mitia : [2, 394]; tous les deux sont des spécialistes des sorties et des entrées brusquées (Dmitri : [1, 44] et [1, 69]) : “Dmitri, qui n’avait jamais été chez lui et ne l’avait jamais vu, - NB : le starets - pensa qu’on voulait l’effrayer de cette façon; mais comme lui-même se reprochait secrètement maintes sorties fort brusques dans sa querelle avec son père, il accepta le défi” ; quant à Fiodor : “Il parut dans la salle à manger au moment où, la prière finie, on allait se mettre à table. Il s’arrêta sur le seuil, examina la compagnie en fixant les gens bien en face et éclata d’un rire prolongé, impudent :
“Ils me croyaient parti, et me voilà!”
cria-t-il d’une voix retentissante. Les assistants le considérèrent un instant en silence, et soudain, tous sentirent qu’un scandale était inévitable” [1, 140]. Un dernier trait commun aux deux hommes est à signaler : chez tous les deux, il existe un décalage entre ce qu’ils vivent à l’intérieur d’eux-mêmes et ce qu’ils expriment au-dehors; de Dmitri, il est écrit : « Même lorsqu’il était agité et parlait avec irritation, son regard ne correspondait pas à son état d’âme. “Il est difficile de sa voir à quoi il pense”, disaient parfois ses interlocuteurs. Certains jours, son rire subit, attestant des idées gaies et enjouées, surprenait ceux qui, d’après ses yeux, le croyait pensif et morose.» [1, 115]; quant à Fiodor, son père, voici ce que nous dit Dostoïevski : « il y a chez les vieux menteurs qui ont joué toute leur vie la comédie, des moments où ils rentrent tellement dans leur rôle qu’ils tremblent et pleurent vraiment d’émotion, bien qu’au même instant, ils puissent se dire (ou bien tout de suite après) : “Tu mens vieil effronté, tu continues à jouer un rôle malgré ta sainte colère”» [1, 123].
Résumons brièvement la deuxième position de notre circuit, celle qu’occupe préférentiellement Mitia Fiodorovitch Karamazov dans le rapport à son père : c’est une position de rivalité narcissique en miroir, teintée de masochisme, caractérisée par la désintrication pulsionnelle (dissociation de la haine et de la sensualité), position de bouffonnerie (comédie, brusques entrées et sorties), accompagnée d’une dissociation entre ce qui est vécu à l’intérieur (sensation) et ce qui est exprimé au-dehors (perception), et cela, bien que le sujet se veuille “entier”.
Quelle est alors la différence entre la première position (Smerdiakov) et la deuxième position (Mitia) ?
Comme nous l’avons dit, par rapport au père Karamazov, Smerdiakov ne se situe pas comme rival. Mitia affirme sa haine, il affirme que les prétentions du faux-frère, du faux-jeton sont à nier. Smerdiakov va jusqu’à nier sa haine (qui au début du roman prend le masque de l’indifférence, de la froideur, avant de sourdre peu à peu quoique toujours contenue, excepté au moment du meurtre), haine qui se trahit déjà dans ce halo d’indifférenciation haineuse primordiale qui l’entoure (haine de Dieu, de la Russie, du sens même de la vie), halo dont le plus fort contraste est l’auréole d’Aliocha, halo de haine qui est à l’auréole ce que l’”apocalyptisme renversé” (Berdiaeff) est à l’apocalyptisme affirmé (l’apocalypse signifiant la révélation - de Dieu -, on peut penser qu’en parlant d’”apocalyptisme renversé” à propos de Smerdiakov, Berdiaeff nous donne à entendre que, pour Smerdiakov, ne peut se révéler que le néant).
Mitia est un “chaud lapin”. Il vit passionnément et exprime ses affects. C’est le plus sensuel des frères Karamazov. C’est un Don Juan, un coureur de jupons. Des quatre frères, il apparaît comme étant le plus mobilisable, à tel point qu’il ne sera pas seulement lui-même mais aussi Smerdiakov, Yvan et Aliocha (à la fin du roman). Hystérique, on peut déjà dire qu’il l’est, au sens où il s’exhibe en ce que Szondi appelle un “flux d’affect hystériforme”, une tempête de mouvement quand, débordé par l’angoisse de conscience (Gewissensangst), il la décharge dans un éclat, un scandale, toute une scène, s’attirant la réprobation de tous.
Yvan Fiodorovitch Karamazov occupe la troisième position de notre circuit. C’est, de tous les frères, la plus tragique figure. Tel Oedipe Roi, il va se lancer dans une enquête à la recherche du parricide, et c’est lui-même qu’il va démasquer en débusquant Smerdiakov. Que va-t-il devenir ? Nous n’en saurons jamais rien. Aliocha va probablement se marier. Mitia va partir au bagne. Mais après son cri lancé en pleine audience du tribunal : “Qui ne désire pas la mort de son père ?”, Yvan disparaît du roman. Qu’est devenu Yvan Karamazov ? Dostoïevski est mort sans nous laisser le moindre pressentiment concernant ce destin.
Mais n’allons pas trop vite. Souvenons-nous qu’Yvan fait son entrée dans le roman en tant que tiers; voici ce que Dostoïevski nous dit d’Yvan tout au début du roman :
“J’ajouterai qu’il tenait lieu d’arbitre et de réconciliateur entre son père et son frère aîné, alors totalement brouillés, ce dernier (NB : Mitia) ayant même intenté une action en justice” [1, 52].
Quel est donc son rapport à son père puisqu’il n’est pas de rivalité directe ? Lisons ce que Dostoïevski nous dit :
“L’aîné, Yvan, devint un adolescent morose, renfermé, mais nullement timide; il avait compris de bonne heure que son frère et lui (NB : son frère est Aliocha) grandissaient chez des étrangers par grâce, qu’ils avaient pour père un individu qui leur faisait honte, etc...” [1, 49].
Ce qui caractérise le rapport d’Yvan à son père, c’est la honte du fils pour le père (honte à la place du père, pourrait-on dire). Yvan est extrêmement secret. Jusqu’avant son dédoublement à la fin du roman, Yvan cache des choses à lui-même et aux autres. Il a caché aux enquêteurs le contenu véritable de sa conversation avec Smerdiakov la veille du crime :
“- Pas de détours. Tu as prédit que tu aurais une crise sitôt descendu à la cave; tu as ouvertement désigné la cave. - Vous l’avez dit dans votre déposition ? demanda Smerdiakov avec flegme. - Pas encore, mais je le dirai certainement. (...)” [2, 284]
Ce qu’Yvan dissimule et se dissimule, c’est très probablement la vraie nature de son rapport avec son père. En effet, en apparence tout au moins, Yvan et son père s’entendent très bien. Au début du roman Dostoïevski écrit :
“Fiodor Pavlovitch l’avait ignoré toute sa vie, (...). Et voilà que le jeune homme s’installe chez un tel père, passe auprès de lui un mois, puis deux, et qu’ils s’entendent on ne peut mieux. Je ne fus pas le seul à m’étonner de cet accord.” [1, 51]
Dès le départ, Yvan nous apparaît comme le plus ambigu, le plus divisé, le plus ambivalent des fils Karamazov. L’ambivalence des affects qui le caractérise ne va faire que s’accroître au fil de l’histoire et son exacerbation conduire Yvan au dédoublement. L’affect haineux, mortifère, sera clivé de l’affect qui lui est opposé et il sera projeté et incarné dans le personnage du diable qu’Yvan hallucinera. Alors que Smerdiakov nie radicalement le désir parricide, alors que Mitia, tout au contraire, le clame avec force, on pourrait reprendre à propos d’Yvan le mot de Freud concernant le savoir de l’hystérique quand il nous dit qu’il s’agit d’un savoir qui s’ignore, “Wissen ohne Wissen”. Telle est exactement la position d’Yvan : il veut tuer et ne veut pas tuer, il sait et ne sait pas son propre désir. Après le meurtre du père, lors des trois entrevues entre Yvan et Smerdiakov, au moment où, sans le savoir, il s’acharne à déterrer et à nier sa propre culpabilité, juste avant son dédoublement, cette position de méconnaissance, de vouloir savoir tout en ne voulant rien savoir, s’accentue à l’extrême :
“Il se sentait tranquillisé par le fait que le coupable n’était pas Smerdiakov, comme on pouvait s’y attendre, mais son frère Mitia. Il ne voulait pas en chercher la raison, éprouvant de la répugnance à analyser ses propres sensations. Il avait hâte d’oublier.” [2, 288]
Effectivement, Yvan veut oublier et n’y parvient pas. La position d’Yvan nous fait songer à celle de l’hystérie de conversion : la conversion hystérique est un oubli qui se souvient. L’affect, cette mémoire phylogénétique, est converti, traduit dans la motilité sans être le moins du monde liquidé. Les hystériques souffrent de réminiscences (Freud). ` La question se pose alors de savoir quel est, chez Yvan, le mode de conversion, de négation de l’affect. La réponse est facile à donner. Si Mitia est d’abord un voyeur, Yvan nous donne à contempler un certain spectacle, un théorème (du grec théorêma, “spectacle”). Quel est donc le sujet de sa contemplation, de sa théorie (du grec théoria, “contemplation”, “étude”) ? Ici aussi Yvan n’est pas sans contradiction. A tel point qu’il cultive la contradiction dans la contradiction. En effet, dans un premier temps, Yvan affirme ne pas croire ni en Dieu, ni en l’immortalité de l’âme :
“Mais dis-moi pourtant, y a-t-il un Dieu ou non ? Seulement il faut me parler sérieusement. - Non, il n’y a pas de Dieu. - Aliocha, Dieu existe-t-il ? - Oui, il existe. - Yvan, y a-t-il une immortalité ? Si petite soit-elle, la plus modeste ? - Non, il n’y en a pas. - Aucune ? - Aucune. - C’est-à-dire un zéro absolu, ou une parcelle ? N’y aurait-il pas une parcelle ? - Un zéro absolu. - Aliocha, y a-t-il une immortalité ? - Oui. - Dieu et l’immortalité ensemble ? - Oui. C’est sur Dieu que repose l’immortalité. - Hum, ce doit être Yvan qui a raison, (...)” [1, 200]
Dans un deuxième temps, plus loin dans le roman, on voit Yvan admettre l’existence de Dieu mais refuser radicalement son univers après avoir un instant auparavant accepté et l’existence de Dieu et la création voulue par Lui :
“Ainsi, j’admets non seulement Dieu, mais encore sa sagesse, son but qui nous échappe; je crois à l’ordre, au sens de la vie, à l’harmonie éternelle, où l’on prétend que nous nous fondrons un jour; je crois au Verbe où tend l’univers qui est en Dieu et qui est lui-même Dieu, à l’infini. Suis-je dans la bonne voie ? Figure-toi qu’en définitive, ce monde de Dieu, je ne l’accepte pas, et quoi que je sache qu’il existe, je ne l’admets pas.” [1, 324]
La théorie d’Yvan est contradictoire. Yvan est un être déchiré. Il pose un terme puis le nie. Ou, plus exactement, son poème intitulé “Le Grand Inquisiteur” nous montre qu’Yvan nie en affirmant : en voulant nier l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme et la divinité du Christ, il ne se rend pas compte que, malgré lui, il les affirme; c’est ce qu’Aliocha lui fait remarquer après avoir écouté “Le Grand Inquisiteur” :
“Mais... c’est absurde, s’écria-t-il en rougissant. Ton poème est un éloge de Jésus, et non un blâme... comme tu le voulais.” [1, 356]
Le sens caché de toute la polémique d’Yvan avec lui-même à travers une théorie manifeste qui porte sur l’existence de Dieu et sa légitimité, le bien-fondé de sa création, de son ordonnancement du monde, renvoie en réalité, à travers ses contradictions et son ambivalence, au désir parricide qu’il porte en lui. Le débat autour du déicide est la traduction manifeste d’un débat plus profond autour de la question du parricide. Le refoulé devenu méconnaissable, désaffecté, intellectualisé, fait retour dans l’acte de refoulement lui-même. Tel est le résultat principal du refoulement : la désaffectation, l’intellectualisation du désir inconscient.
Yvan s’entend donc relativement bien avec son père réel, Fiodor Karamazov. C’est ce que peut constater n’importe quel observateur extérieur. Plus encore, nous avons vu qu’Yvan avait à jouer un rôle de tiers dans la rivalité qui oppose Mitia à Fiodor. Ce père réel est un père de mensonge, de chaos, de sensualité. C’est au père législateur qu’Yvan Karamazov s’attaque. Ou mieux : à la fonction législatrice du père telle que Dieu la figure pour lui. Son univers est mal fichu, injuste, cruel. Yvan s’attaque au bien-fondé de la création et de ses lois. C’est en cela que ses velléités de parricide prennent des manières de déicide : dans l’ambivalence, dans la négation qui affirme en la niant la légitimité, voire l’existence même, du législateur. Yvan, l’intellectuel, nie le Mitia, le sensuel, qu’il porte en lui. Il nie ses velléités parricides en les affirmant dans une théorie déicide.
Aliocha Karamazov occupe la quatrième et dernière position de notre circuit. Le roman se termine également avec lui. La scène est touchante : Aliocha et les gamins sont réunis autour de la tombe du petit Illioucha, le fils du capitaine que Mitia avait humilié. Illioucha, qui est mort de tuberculose, vient d’être enterré. Illioucha est mort de chagrin, il a été le complice de Smerdiakov dans le meurtre du pauvre chien Scarabée et il ne s’est jamais remis de l’humiliation publique que Mitia a fait subir à son père, le capitaine. Illioucha avait pris la défense de l’honneur de son père qui, lui aussi, comme le père Karamazov, nous est présenté par Dostoïevski comme un alcoolique, un bouffon. Le roman se termine sur la mort d’un fils. Signifie-t-elle un contrepoids ou le rachat du meurtre du père Karamazov ? Nous savons que pour Freud, le péché originel n’est rien d’autre que le meurtre du père de la horde primitive (dans cette perspective, pour Freud également, la culpabilité est universelle, supra- ou trans-individuelle) et la mort du Christ, celle du fils qui se sacrifie dans l’espoir de sauver ses frères du poids de la culpabilité. Pour en revenir aux frères Karamazov, Illioucha est-il Aliocha enfant ? Est-ce son enfance qu’Aliocha enterre à la fin du roman ? Dans les brouillons des frères Karamazov, Dostoïevski prête à Aliocha un rêve étrange qui n’est pas repris dans la version définitive. Le voici (page 970, la Pléiade) :
“Aliocha : il voit Noiraud en rêve, le garçon pleure, trouvez-moi Noiraud. Dommage que vous n’avez pas trouvé Noiraud, vous étiez le dernier espoir. Le père espérait en vous. Oui dommage.”
Noiraud, c’est le chien qui, dans la version définitive, s’appellera Scarabée, le chien tué par Smerdiakov avec la complicité innocente d’Illioucha qui ensuite en meurt de chagrin. Le père d’Illioucha espère, pour sauver son fils, que Kolia Krassotkine retrouvera le chien en question (un doute en effet plane sur la mort de Scarabée). C’est le premier sens de la phrase qu’Aliocha entend en rêve : “Vous étiez le dernier espoir. Le père espérait en vous. Oui dommage”. Le père, c’est le père d’Illioucha, mais n’est-ce pas aussi celui d’Aliocha lui-même, le père Karamazov ? Est-ce qu’Aliocha ne se reproche pas en rêve de n’avoir pas tout fait pour éviter la mort de son père ? Le rêve dit aussi : “le garçon pleure”; est-ce que l’identité entre les pères ne conduit pas logiquement à l’identité entre Illioucha et Aliocha ? Si tel était le cas, ce serait bien sa propre enfance qu’Aliocha enterre à la fin du roman; c’est comme s’il se disait : “mon père est mort et avec lui l’enfant que j’étais”.
Continuons d’examiner cette “dernière scène” dans laquelle Aliocha, entouré des enfants sur la tombe d’Illioucha, leur livre ses dernières recommandations. Que recommande-t-il en fait ? Laissons-lui la parole :
“Mes colombes, laissez-moi vous appeler ainsi, car vous ressemblez tous à ces charmants oiseaux - tandis que je regarde vos gentils visages, mes chers enfants, peut-être ne comprendrez-vous pas ce que je vais vous dire, car je ne suis pas toujours clair, mais vous vous le rappellerez et, plus tard, vous me donnerez raison. Sachez qu’il n’y a rien de plus noble, de plus fort, de plus sain et de plus utile dans la vie qu’un bon souvenir, surtout quand il provient du jeune âge, de la maison paternelle. On vous parle beaucoup de votre éducation; or un souvenir sain, conservé depuis l’enfance, est peut-être la meilleure des éducations : si l’on fait provision de tels souvenirs pour la vie, on est sauvé définitivement.” [2, 479]
Aliocha devient un père pour ces petits enfants. Les trois pages de son discours contiennent un leitmotiv : souvenons-nous, commémorons, n’oublions jamais notre communion [478] ici même autour du souvenir d’Illioucha. Alors qu’Yvan s’acharne, dans un oubli qui se souvient, à nier sa participation indirecte au parricide, Aliocha s’efforce d’entretenir la flamme d’un souvenir acceptable; “acceptable”, c’est-à-dire qui ménage une part à l’oubli dans une sorte de déplacement : ce n’est pas le meurtre du père qui est directement commémoré mais la mort du fils qui en est le corrélat obligé dans la mesure où, avec la mort du père, c’est une part de sa propre enfance - de lui-même enfant - que le fils enterre.
Mais cette scène se passe après la mort de Fiodor Karamazov. Quelle est avant le parricide l’attitude d’Aliocha vis-à-vis de son père ? Nous verrons plus loin qu’il a pris, à son insu, une part active dans le parricide. D’une manière générale, Aliocha s’entendait très bien avec son père et l’on peut affirmer qu’il exerçait même sur ce dernier une influence bénéfique. N’oublions pas qu’Aliocha avait, dès le début du roman, une sorte de “père symbolique” en la personne du starets Zossime. Comme c’est le cas pour son frère Yvan, Aliocha va faire porter son désir, son intérêt, sur la question de Dieu. Sa théorie (contemplation) à lui est une théologie, c’est-à-dire qu’il va affirmer ce qu’Yvan s’efforce en vain de nier pour lui-même : l’existence du Père universel, législateur légitime. Plus encore : nous verrons que pour Aliocha, Dieu-Le-Père est au-dessus de la morale, qu’il n’est pas un Dieu simplement moral. C’est cette idée, qu’il se fait du Père, qui lui permettra d’aimer son père Fiodor, tout immoral qu’il soit (ce que ne peut pas faire Yvan); ne dit-il pas à son père :
“- Non, je ne vous en veux pas. Je connais vos pensées . Votre coeur vaut mieux que votre tête. - Mon coeur vaut mieux que ma tête... Et c’est toi qui dis cela...” [1, 201]
II. SPÉCIFICITÉ DU CIRCUIT KARAMAZOVIEN
A. Avant le parricide : implications mutuelles
Selon l’étymologie, “implicare” signifie “envelopper”. Du latin “implicitus” est dérivé l’adjectif français “implicite”. Dans notre circuit, la seconde position implique la première; la troisième implique la seconde et la première; la quatrième implique la troisième, la seconde et la première.
Smerdiakov, qui occupe la première position, n’est que lui-même. Mitia est explicitement le rival de son père dans la mesure où il recèle implicitement en lui un Smerdiakov : souvenons-nous de l’irruption brutale qu’il fit chez son père en le frappant cruellement [1, 207]. Nous avons vu qu’Yvan Karamazov, en troisième position, niait le Mitia qu’il porte en lui. Il y a en Yvan un sensuel, un affectif, auquel il s’oppose : en témoigne son approche relativement froide et intellectuelle de Katerine Ivanovna. Cette opération de négation a pour effet de rapprocher Yvan de Smerdiakov, de le faire ressembler à ce dernier, à cette différence près qu’Yvan est beaucoup plus complexe, contradictoire, ambigu, ambivalent, dans sa polémique interne avec lui-même et son père que ne l’est le personnage de Smerdiakov. Une certaine dissociation, qui apparaît déjà dans le chef de Mitia (entre son intérieur et son extérieur), est cette fois entièrement intériorisée, cachée dans le for intérieur d’Yvan. Une ressemblance frappante entre Yvan et Smerdiakov apparaît notamment dans le fait qu’ils nient tous les deux l’existence de Dieu. Enfin, en quatrième position, nous trouvons un Aliocha qui recèle en lui un Smerdiakov, un Mitia, un Yvan. Cependant, Aliocha n’est ni la synthèse, ni la sommation de ses trois frères. Aliocha est Smerdiakov dans la crise d’hystéro-épilepsie qu’il présente au début du roman [1, 204]. Il est Mitia dans son amour pour la petite Lise ou encore dans la scène qu’il présente chez et avec Grouchegnka (certes, après la mort de son starets [1, 465]), scène toute empreinte de sensualité. Il est Yvan parce qu’il se cache à lui-même son désir parricide ou la possibilité du parricide ([1, 208 et 211] : à comparer avec [2, 290]), qu’il a menti à Yvan et à lui-même lorsque fut évoquée par Yvan la possibilité du parricide et qu’il se révolte en parlant comme lui [1, 454]. Aliocha est tout cela et il est aussi quelque chose de plus : celui dont la tâche est de “ne pas oublier”, d’ être dans le monde, parmi ses frères, en train de tenter de les réconcilier avec Fiodor; le starets a dit à Aliocha :
“Travaille, travaille sans cesse. Rappelle-toi mes paroles; (...) Va et dépêche-toi. Demeure auprès de tes frères, et non pas seulement auprès de l’un, mais de tous les deux.” [1, 128].
B. Les axes diagonaux, horizontaux et verticaux
1. Les diagonaux : Smerdiakov et Mitia, Yvan et Aliocha
Smerdiakov et Mitia apparaissent comme des praticiens ou des acteurs du parricide alors qu’Yvan et Aliocha apparaissent plutôt comme des théoriciens ou des spectateurs du parricide. Sur le terrain, il existe un soutien logistique entre Mitia et Smerdiakov : ce dernier lui a communiqué le code secret qui signifie pour le père Karamazov l’arrivée de sa bien-aimée Grouchegnka au seuil de sa demeure et lui a aussi communiqué un faux emplacement de l’enveloppe contenant les 3000 roubles [2, 307]. Quant à Yvan et Aliocha, ils développent chacun à leur manière une théorie, une contemplation, qui leur permet de ne pas voir ce qui se prépare ou de ne pas y croire [1, 211] :
“(NB : Yvan) Me crois-tu capable, comme Dmitri, de verser le sang d’Esope, de le tuer enfin ? - Que dis-tu Yvan ? Jamais cette idée ne m’est venue. Et je ne crois pas que Dmitri ...”.
2. Le horizontaux : Aliocha et Mitia, Yvan et Smerdiakov
Aliocha et Mitia occupent les positions connotées positivement, à valence érotique : Aliocha, parce qu’il s’efforce de relier ce qui se trouve séparé et Mitia, parce qu’il est un sensuel, amateur du beau sexe. Par contre, Yvan et Smediakov occupent des positions connotées négativement, à valence thanatique : Smerdiakov est le négateur par excellence, c’est lui qui tuera réellement; quant à Yvan, il se dévitalise, il se désaffecte : Mitia dit d’Yvan qu’il est un tombeau ([1, 317-318-319] : “cimetière”; “tes morts”; “C’est à cause de Smerdiakov que tu t’es assombri ?”). Quant à Smerdiakov, dès son plus jeune âge, il aime à pendre les chats et est attiré par le mortifère [1, 187]; il moque et tourne en dérision la création du monde. Il y a d’autre part une collusion secrète entre Yvan et Smerdiakov : le “tout est permis” d’Yvan (position 3) résonne en Smerdiakov (position 1) comme le “nous sommes tous coupables” d’Aliocha (position 4) résonnera plus tard en Mitia (position 2). Ou encore : Smerdiakov donne corps à la théorie d’Yvan, et Mitia à celle d’Aliocha :
(idée)
Mitia va incarner, va vivre, va découvrir, va mettre en pratique la théorie de l’omniculpabilité.
3. Les verticaux : Aliocha et Smerdiakov, Yvan et Mitia
Smerdiakov est l’épileptique avéré, le sombre contemplateur à “l’apocalyptisme renversé”. Aliocha est l’épileptique extatique, apocalyptique, révélateur du Père, de Dieu (alors que Smerdiakov est l’épileptique négateur du père). Mitia, lui, est l’hystérique enflammé, affirmant tempétueusement son affect alors qu’Yvan est semblable à l’hystérique de conversion : refroidi, niant l’affect, apparemment indifférent. Alors que les positions 1 (Smerdiakov) et 4 (Aliocha) sont en opposition dans la discontinuité (notons-le bien : ce sont deux positions épileptiques), les positions hystériques 2 (Mitia) et 3 (Yvan) sont en opposition dans la continuité.
En effet, sur le plan strictement clinique, dans l’épilepsie, la phase critique (position 1) et celle de la réparation (position 4) marquée par l’obséquiosité et la culpabilité sont séparées par une phase post-critique de sommeil, de migraine, ou de quelque autre phénomène, qui vient médiatiser le rapport de négation de l’attaque morbide (e-) à la réparation (e+), instaurant entre ces deux dernières une discontinuité temporelle; dans l’hystérie, par contre, la position d’affectation (hy+) (position 2) est le plus souvent suivie immédiatement par la position de désaffectation ou de refoulement (position 3) (hy-) à l’intérieur d’une continuité temporelle dans laquelle s’inscrit cette négation.
Sur le plan du roman, on constate qu’entre Smerdiakov (position 1) et Aliocha (position 4), il existe une distance maximale : ils ne se parlent quasiment jamais de manière directe dans toute le roman sauf dans le passage intitulé “Smerdiakov et sa guitare”. Par contre, entre Yvan et Mitia, la distance est plus réduite puisque, comme nous allons le voir, ils vont échanger leur position après le parricide. On remarque d’autre part qu’Yvan passe très rapidement et facilement de l’affirmation sous-entendue de son parricide (hy+) [1, 208] à sa négation radicale (hy-) [1, 211].
C. Après le parricide : Mitia et Yvan s’échangent
1. Yvan va passer de la troisième à la deuxième position du circuit.
Lors de ses trois entretiens avec Smerdiakov après le meurtre, Yvan se défend avec acharnement contre toute culpabilité. Ces entretiens lui dévoilent peu à peu qu’il a pris part au parricide via Smerdiakov. C’est Yvan qui interroge ce dernier et c’est Yvan qui se démasque lui-même. Au moment même où sa propre culpabilité ne lui fait aucun doute, il dit à Smerdiakov :
“Sais-tu que j’ai peur que tu ne sois un fantôme ?” [2, 304]
Quelques heures plus tard, Yvan est halluciné (vomit son père par les yeux) : il voit le diable lui apparaître , il hallucine tout ce que sa théorie du “Tout est permis” recélait de diabolique, de parricide, de déicide, de suicide. Yvan dit au diable :
“Tu es une hallucination, l’incarnation de moi-même, d’une partie seulement de moi... de mes pensées et de mes sentiments, mais des plus vils et des plus sots” [2, 319]
Yvan a abandonné la troisième position, son habituelle, celle du mensonge à soi-même; comment pourrait-il en être autrement puisque maintenant, il sait ? Yvan est débordé par ses affects plus que ne l’a jamais été Mitia. Le “double” de ce dernier était un personnage réel, existant hors de lui, c’est-à-dire son père, et non une part de lui-même hallucinée comme c’est le cas pour Yvan.
C’est en sortant de son dernier entretien avec Smerdiakov qu’Yvan commence à s’incarner :
“Il marcha d’abord d’un pas assuré, mais bientôt se mit à chanceler. “Ce n’est que physique”, songea-t-il en souriant.” [2, 315]
Il se met à éprouver de bons sentiments; lui qui déclarait que :
“C’est précisément, à mon idée, le prochain qu’on ne peut aimer” [1, 326]
Le voilà qu’il secourt un inconnu, un ivrogne qu’il avait tout à l’heure renversé dans la neige, le voilà en train de devenir un bon samaritain :
“il fit examiner le croquant par un médecin en payant généreusement les frais”.
Mais Yvan demeure foncièrement ambivalent, pris dans un flux d’affects contradictoires qu’il ose maintenant manifester (on dirait, vulgairement, qu’il “s’extériorise”) :
“Une sorte d’allégresse le gagnait .” [2, 315] “Il sourit, mais le rouge de la colère lui monta au visage.” [2, 316]
Yvan veut aller sur-le-champ se dénoncer chez le procureur mais ce n’est pas à proprement parler du repentir. Non, Yvan veut se punir, se faire mal, par haine de lui-même et de Smerdiakov; il déclare à ce dernier :
“Je te répète que si je ne t’ai pas tué, c’est uniquement parce que j’ai besoin de toi demain; ne l’oublie pas” [2, 314]; (“demain”, c’est-à-dire au tribunal).
Un peu plus loin Aliocha déclare à propos d’Yvan :
“Ou Yvan se relèvera à la lumière de la vérité, ou bien... il succombera dans la haine, en se vengeant de lui-même et des autres pour avoir servi une cause à laquelle il ne croyait pas” [2, 341]
Au tribunal, Yvan fera une piètre exhibition. Alors que Mitia rugissait :
“Pourquoi un tel homme existe-t-il ?”
Yvan s’écriera en pleine audience :
“Qui ne désire pas la mort de son père ?” [2, 375]
Ce que Mitia était capable de formuler avant le meurtre (le désir parricide), Yvan ne peut l’exprimer que longtemps après.
Tous ces éléments (l’affectation, l’incarnation, le dédoublement, l’exhibition du désir parricide, le masochisme, etc...) montrent que la régression d’Yvan après le meurtre se fait dans le sens du passage de la troisième à la deuxième position.
2. Mitia va passer de la deuxième à la troisième position et de la troisième à la quatrième.
Alors qu’il fait bombance à Mokroïé avec Grouchegnka, on vient arrêter Mitia. Mitia commence par nier sa culpabilité :
“Je ne suis pas coupable, je n’ai pas versé le sang de mon père... Je voulais le tuer mais je suis innocent. Ce n’est pas moi” [ 2, 111]
Mitia doit ensuite se déshabiller devant le procurer et le juge :
“Il était très gêné et, chose étrange, se sentait comme coupable, lui nu, devant ces gens habillés, trouvant presque qu’ils avaient maintenant le droit de le mépriser, comme inférieur. “La nudité en soi n’a rien de choquant, la honte naît du contraste, songeait-il. On dirait un rêve, j’ai parfois éprouvé en songe des sensations de ce genre”. Il lui était pénible d’ôter ses chaussettes, assez malpropres, ainsi que son linge, et maintenant tout le monde l’avait vu. Ses pieds surtout lui déplaisaient, il avait toujours trouvé ses orteils difformes, particulièrement celui du pied droit, plat, l’ongle recourbé, et tous le voyaient. Le sentiment de sa honte le rendit plus grossier, il ôta sa chemise avec rage.” [2, 140]
Quelques pages plus loin, Mitia affirme encore :
“Je le jure devant Dieu, je suis innocent de la mort de mon père.” [2, 164]
Les rôles ont changé : Mitia n’est plus le voyeur; c’est lui “qui est vu” comme dit l’expression. Il a honte, il se sent presque coupable. Que les rôles aient changé entre le représentant de la loi et lui, c’est à n’en point douter si l’on se rapporte à un autre morceau du dialogue entre le procureur et l’inculpé :
“Voyez-vous, messieurs, en vous écoutant, il me semble faire un rêve, comme ça m’arrive parfois.. . Je rêve souvent que quelqu’un me poursuit, quelqu’un dont j’ai grand-peur et qui me cherche dans les ténèbres. Je me cache honteusement derrière une porte, derrière une armoire. L’inconnu sait parfaitement où je me trouve, mais il feint de l’ignorer, afin de me torturer plus longtemps, de jouir de ma frayeur... C’est ce que vous faites maintenant. - Vous avez de pareils rêves ? s’informa le procureur. - Oui, j’en ai... Ne voulez-vous pas le noter ? - Non, mais vous avez d’étranges rêves. - Maintenant, ce n’est plus un rêve. C’est la réalité, messieurs, le réalisme de la vie. Je suis le loup, vous êtes les chasseurs.” [2, 126]
Autrefois, Mitia était voyeur dans la vie (il était le chasseur, il épiait son père, il tentait de s’immiscer dans sa maison) et il était gibier dans le rêve; maintenant, c’est dans la réalité qu’il occupe la troisième position, celle de celui qui se cache, qui a honte.
Après l’interrogatoire des témoins, Mitia s’endort sur une malle dans le lieu même de son arrestation tandis que l’on procède à la rédaction définitive du procès-verbal. Il va faire un rêve étrange qui va confirmer - en rêve cette fois - son passage à la troisième position.
C’est le fameux rêve du petiot [2, 165-166-167] à l’issue duquel Mitia va passer de la troisième à la quatrième position. Mais pendant le rêve même, Mitia est, comme son frère Yvan (troisième position), face à la souffrance des enfants innocents et comme Yvan, il questionne :
“Pourquoi pleure-t-il ? demanda Mitia en passant au galop.” “Pourquoi ses petits bras sont-ils nus ? pourquoi ne le couvre-t-on pas ?” “... dis-moi pourquoi ces malheureuses se tiennent-elles ici, pourquoi cette détresse, ce pauvre petiot, pourquoi la steppe est-elle nue, pourquoi ces gens ne s’embrassent-ils pas en chantant des chansons joyeuses, pourquoi sont-ils si noirs, pourquoi ne donne-t-on pas à manger au petiot ?” [2, 166]
Pourquoi, pourquoi, pourquoi : telle était l’obstination d’Yvan face à l’injustice, face au mal qui est dans le monde, face à la douleur pour rien des enfants innocents. Ce pourquoi adressé par Yvan à Dieu l’avait amener à se révolter théoriquement contre ce mauvais père. Car Yvan voulait comprendre Dieu avant de croire en Lui comme il voulait comprendre le sens de la vie avant de vivre [1, 319].
A l’issue de ce rêve, Mitia va accéder à une première forme de reconnaissance de sa culpabilité en tenant un discours très proche de celui d’Aliocha et du starets Zossime qui occupent, quant à eux, la quatrième position de notre circuit, celle qui, au-delà du “Tout est permis” d’Yvan, affirme “Nous sommes tous coupables”. Voici en effet ce que Mitia - encore ambivalent, il faut le dire - déclare après s’être réveillé :
“Messieurs, nous sommes tous cruels, tous des monstres, c’est à cause de nous que pleurent les mères et les petits enfants, mais parmi nous, je le proclame, c’est moi le pire. (...) J’accepte les tortures de l’accusation, la honte publique. Je veux souffrir et me racheter par la souffrance” [2, 168]
Dès cet instant, Mitia ne va plus cesser de tendre à l’omniculpabilité salvatrice. La veille du procès, il déclarera à Aliocha venu le voir en prison :
“Frère, j’ai senti naître en moi, depuis mon arrestation, un nouvel être; un homme nouveau est ressuscité. Il existait en moi, mais jamais il ne se serait révélé sans le coup de foudre. (...) Pourquoi ai-je rêvé alors du “petiot”, à tel moment ? C’était une prophétie. J’irai pour le “petiot”. Car tous sont coupables envers tous. Tous sont des “petiots”, il y a de grands et de petits enfants. J’irai pour eux, il faut que quelqu’un se dévoue pour tous. Je n’ai pas tué mon père, mais j’accepte l’expiation” [2, 267]
Ce rêve a permis à Mitia de ne pas se révolter contre son arrestation car il a pris conscience de sa culpabilité, à l’opposé d’Yvan qui, devant le petiot, étouffait son propre sentiment de culpabilité pour accuser son père à lui, sous la figure de Dieu.
D. Tétralogies : quatre modalités de “clusion”, de centration, de culpabilité, de discours, d’éthicité.
1. Smerdiakov
Des quatre frères, Smerdiakov est celui qui exclut :
a) le père Karamazov - et radicalement - puisqu’il le tue; b) Yvan, puisqu’il fait en sorte que ce dernier s’exclue de lui-même, la veille du crime, en partant pour Tchermachnia, c’est-à-dire en laissant le champ libre au meurtrier, comme s’il disait à Smerdiakov, “Tu vois, je pars pour Tchermachnia, je m’exclus du terrain, tu peux tuer le vieux, vas-y, exclus-le”; c) mais Smerdiakov exclut aussi lui-même, en se suicidant, en excluant le monde entier dans lequel il ne saurait pas ne pas se trouver : “Je hais la Russie entière” dit-il [1, 311], or il est russe. On retrouve ici à nouveau l’indifférenciation primordiale dans laquelle baigne le monde de Smerdiakov.
L’exclusion ne signifie pas la libération de l’exclu mais son enfermement au dehors (excludere, ex-claudere : littéralement : “enfermer au dehors”). Il est en effet évident que l’auto-exclusion d’Yvan, son départ pour Tchermachnia signifie son enfermement dans la complicité du meurtre qui va être commis.
Smerdiakov est aussi l’excentrique : il n’a pas son centre en lui-même, son centre est en Yvan car il tue le père afin d’accomplir le désir parricide d’Yvan. On a l’impression que Smerdiakov, bien qu’il soit le meurtrier effectif, n’est pas au centre des événements. Il est par exemple étonnant que la plupart des commentateurs qui s’attachent à décrire la “psychologie” des frères Karamazov oublient Smerdiakov comme s’il n’y avait que trois frères[4]. Cette excentricité de Smerdiakov, qui fait qu’on l’oublie, vient de ce qu’il n’est pas un fils légitime du père Karamazov mais seulement son fils naturel supposé.
Smerdiakov commet le parricide en action : il tuera réellement le père et il se tuera ensuite. C’est lui le meurtrier réel et c’est le seul des frères à ne pas se sentir coupable.
Quelle est donc la position de Smerdiakov par rapport à la culpabilité ? La culpabilité est un donné. Tout individu humain qui naît tombe dans ce pétrin. Les théologiens, tout comme Freud, voient dans la culpabilité une catégorie universelle constitutive de notre humanité. Le désir sourd des marécages de l’angoisse et de la culpabilité. Le désir abouti ou accompli - au sens de l’accomplissement d’une oeuvre, d’un travail - est un remède contre l’angoisse et la culpabilité; il doit être conquis contre elles. La culpabilité en soi n’est pas nécessairement pathologique. Freud affirme que ce qui est pathologique ou non, c’est ce que l’on fait de la culpabilité. En effet, Freud nous montre que la culpabilité peut s’exprimer de diverses manières : dans la crise d’épilepsie, dans le meurtre, dans l’inhibition au travail, dans les dettes de jeu, dans la religiosité ou l’oeuvre de civilisation. Mais revenons à Smerdiakov. Sa position fondamentale par rapport à la culpabilité est la suivante : il n’y a pas de culpabilité (comme on dirait “il n’y a pas de mal à ça”, “il ne pleut pas”). Nous avons vu que, pour Smerdiakov, tout peut être justifié; rien n’est fondé, rien n’est définitif; tout est égal : le mal au bien, le bien au mal, le martyre au reniement, etc... Il ne s’agit pas d’un déni, ce qui signifierait que la culpabilité est à la fois reconnue et niée. Il s’agit d’une négation radicale, d’une forclusion, au sens exact de ce terme :
“forclore : en termes de pratique, exclure de faire quelque production en justice, après certains délais passés. Il s’est laissé forclore. Forclore quelqu’un de produire (NB : une action en justice). Le sens propre et primitif est exclure.” (Littré)
Il est exclu de prendre en considération la culpabilité : elle ne saurait avoir droit de cité. Pourquoi déclare-t-il alors à Yvan :
“... vous êtes pourtant coupable de tout; en effet, vous étiez prévenu de l’assassinat, vous m’avez chargé de l’exécution et vous êtes parti. Aussi, je veux vous démontrer ce soir que le principal, l’unique assassin, c’est vous, et non pas moi, bien que j’aie tué. Légalement, vous êtes l’assassin.” [2, 308]
Avant de répondre à cette question, n’oublions pas que Smerdiakov ne veut absolument pas qu’Yvan se rende au tribunal pour se dénoncer :
“Vous-mêmes répétiez sans cesse que tout est permis, pourquoi êtes-vous si inquiet maintenant ? Vous voulez même vous dénoncer. Mais il n’y a pas de danger. Vous n’irez pas, dit-il catégoriquement.” [2,314]
Si Smerdiakov feint de culpabiliser Yvan, ce n’est pas qu’il reconnaît l’existence d’une quelconque culpabilité, c’est qu’il attend d’Yvan un démenti tout aussi catégorique : “moi, Yvan, je ne suis pas coupable non plus”. Or Yvan ne réagit pas du tout de cette manière mais il se laisse progressivement submerger par son propre sentiment de culpabilité. Il ne faut pas croire non plus que si Smerdiakov se tue, c’est par remords ou par repentir. Smerdiakov se tue en ne laissant aucune lettre, aucun aveu écrit. Son suicide est autant allo-agressif qu’auto-agressif : en se tuant, il va laisser condamner Mitia. En se suicidant, Smerdiakov se perd et perd autrui. Il se tue par haine de soi et d’autrui ainsi que le fait remarquer à l’audience l’avocat de Mitia :
“Mais pourquoi, s’exclame l’accusation, Smerdiakov n’a-t-il pas avoué dans un billet écrit avant de mourir ? “Sa conscience n’est pas allée jusque-là.” Permettez; la conscience, c’est déjà le repentir, peut-être le suicidé n’éprouvait-il pas de repentir, mais seulement du désespoir. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Le désespoir peut être méchant et irréconciliable, et le suicidé, au moment d’en finir, pouvait détester plus que jamais ceux dont il avait été jaloux toute sa vie”. [2, 438]
De Smerdiakov, que peut-on dire encore ? Fiodor Pavlovitch avait une confiance totale en lui :
“Il le savait foncièrement honnête, incapable de dérober quoi que ce fût, et c’était l’essentiel.” [1, 190]
Or Smerdiakov va lui dérober 3000 roubles et l’assassiner. Smerdiakov n’a aucune droiture, il est tout de fausse rectitude. Son discours - quand il parle, car l’ânesse de Balaam est avare de parole - est à son image : un discours en zigzag. D’une part, son discours se donne pour droit : quand Dostoiëvski décrit la manière dont parle Smerdiakov, il utilise les expressions suivantes : “fermement”, “avec un regard pénétrant”, “avec assurance”, “d’un ton ferme”, “d’un air doctoral”, “avec calme et très nettement”, “posément (...) tout en fixant Yvan”, etc... (voir notamment [I, 361] et sequi]; d’autre part, il n’échappe pas à Dostoïevski que ce discours est dévié, que cette rectitude est faussée :
“Mais l’oeil gauche, clignant et paraissant faire allusion, rappelait l’ancien Smerdiakov.” [2, 283]
“Smerdiakov eut un mauvais regard, son oeil gauche se mit à cligner, comme pour dire, avec sa réserve habituelle : ‘Tu veux y aller carrément, soit’ “[2, 292]
“ Smerdiakov s’arrêta, Yvan l’avait écouté dans un silence de mort, sans bouger, sans le quitter des yeux. Smerdiakov lui jetait parfois un coup d’oeil, mais regardait surtout de côté.” [2, 311]
Dans l’épisode déjà mentionné, relaté dans le chapitre “Une controverse”, là où il s’attaque à la foi chrétienne, Smerdiakov parle au père Karamazov mais son discours cherche en fait à blesser son père adoptif, le serviteur Grigori (ce discours amuse Fiodor mais blesse, pourfend le vieux Grigori, fidèle à la foi) qui se tient quelque part dans la pièce sans mot dire :
“Smerdiakov s’adressait avec une satisfaction visible à Grigori, tout en ne répondant qu’aux questions de Fiodor Pavlovitch; ...” [1, 193]
Mais c’est là une diversion qui en contient une autre car, en réalité, c’est à Yvan que Smerdiakov s’adresse et non pas à Grigori ou à Fiodor :
“Yvan, s’écria Fiodor Pavlovitch, penche-toi à mon oreille, c’est pour toi qu’il pérore, il veut recevoir tes éloges. Fais-lui ce plaisir.” [1, 193]
Le discours de Smerdiakov est donc un discours faussement droit, en zigzag, qui cherche à meurtrir autrui.
Pour en terminer avec Smerdiakov, je voudrais signaler que, du point de vue des catégories de l’éthique, c’est à celle de la loi que Smerdiakov se rapporte et qu’il s’y rapporte sur un mode négatif.
Dostoïevski a fait porter tout l’accent de son roman sur le “tu ne tueras pas”. L’importance de l’interdit du meurtre vient occulter celle de la prohibition de l’inceste dont il n’est nullement question de manière directe. La prohibition de l’inceste est cependant présente de manière indirecte via la présence du complément d’objet direct du verbe “tuer” : le père. Et pourquoi tuerait-on le père si ce n’est pour hériter de la mère ? Or la question de l’héritage de sa mère est une des causes centrales du litige entre Mitia et son père :
“Le désaccord entre Dmitri et son père au sujet de l’héritage de sa mère atteignait alors a son comble.” [1, 68]
Mais revenons à Smerdiakov. Que sait-t-on de lui ? Tout d’abord, qu’il est un enfant illégitime, naturel. Enfin, que son père adoptif, le serviteur Grigori, lui déclara un jour qu’il n’était pas un être humain mais qu’il était né de l’humidité des étuves [1, 187].
Smerdiakov nous apparaît d’emblée comme exclu de la société et de la fratrie. Et peut-être que tuer le père prit pour lui la signification d’une réintégration de la fratrie, quoique sur un mode illégitime ?
Et pourtant, par trois fois, Smerdiakov va prendre des airs d’homme de loi : a) sur le plan de la loi de la science :
“Dieu a créé le monde le premier jour, le soleil, la lune et les étoiles le quatrième jour. D’où venait donc la lumière le premier jour ?” [1, 187];
b) sur le plan de la loi morale ou religieuse :
“il n’y aurait eu en pareil cas, aucun péché à renier le nom du Christ et le baptême, pour sauver ainsi sa vie et la consacrer aux bonnes oeuvres,...” [1, 192];
c) sur le plan strictement juridique :
“Légalement, vous être l’assassin.” [2, 308].
Dans les trois cas, Smerdiakov est dans l’erreur. Comment pourrait-il en être autrement puisque, depuis toujours déjà, Smerdiakov est en dehors de toute légalité ? En effet, la loi a pour première fonction d’assurer l’intégration harmonieuse des parties dans le tout. Elle est lien (St. Thomas : lex, ligare, lier, obliger), articulation de ce qui est disjoint tout en sauvegardant la différenciation des éléments dans le tout. Or Smerdiakov est l’exclu, le disjoint et il est aussi celui qui exclut, qui disjoint, qui défait les liens dans ce que nous avons appelé la confusion ou l’indifférenciation haineuse primordiale; une deuxième fonction de la loi est qu’elle n’existe pas en soi mais pour un être humain qui tend à connaître et à se connaître, à situer et à se situer dans l’univers, vis-à-vis d’autrui et de soi; or, Smerdiakov ne se situe que par rapport à la loi d’Yvan qu’il aime autant qu’il hait, loi qui lui dit que “tout est permis”, sous-entendu : “tuer son père”; et cette loi est le contraire de la loi; enfin, une troisième fonction de la loi est qu’elle n’est pas une fin (lettre de la loi) mais un moyen (esprit de la loi); or, Smerdiakov prend à la lettre le chapitre de la Genèse ou encore la théorie d’Yvan (Tout est permis) et la loi, qui devient pour lui une fin, devient facteur de mort.
Exclu, rejeté, interdit par la loi qui lui tombe dessus depuis toujours (c’est ainsi qu’il se vit), Smerdiakov va s’emparer rageusement de la loi et, détruisant par elle, il va la détruire elle. Entre ses mains, elle va devenir un instrument de mort. Hors-la-loi, il est aussi hors du droit (ensemble articulé de lois), de la morale (l’instance critique du droit) et de l’éthique (accomplissement de la loi dans l’au-delà d’elle-même). Smerdiakov est l’homme de la loi au sens de génitif objectif (celui qui est exclu).
2. Mitia
Mitia est de toute évidence celui qui s’inclut. L’idée que Grouchegnka pourrait se trouver en compagnie de son père, c’est-à-dire dans la chambre de ce dernier, le fascine, l’obsède [2, 39-40-41]. Il voudrait s’inclure dans la “scène primitive” (fantasme originaire selon Freud) afin d’y prendre la place du père. Il rôde autour de la maison du père et il lui est interdit d’y entrer. Cependant, il y fait une fois une entrée brusque, violente [1, 205] parce qu’il croit que Grouchegnka se trouve en compagnie de Fiodor Pavlovitch.
Mitia tourne donc et autour de Grouchegnka et autour de son père. Son rêve est d’être lui-même le centre. Étant donné qu’il est dans un rapport de rivalité narcissique en miroir avec son père, on peut dire de Mitia qu’il est déjà à lui-même son propre centre. En témoigne la conscience qu’il a de son désir parricide, désir au centre duquel il se tient. Plusieurs passages du roman nous montrent bien que Mitia est effectivement celui qui tourne autour et celui autour duquel tout tourne :
“Pourquoi un tel homme existe-t-il ? rugit sourdement Dmitri Fiodorovitch, que la colère égarait et qui leva les épaules au point d’en être bossu... Dites-moi, peut-on encore lui permettre de déshonorer la terre ?” Il eut un regard circulaire et désigna le vieillard de la main.” [1, 123]
Plus loin, dans la même scène, Mitia sera le centre car c’est devant lui seul que le starets se prosternera. Bien plus tard, après le meurtre, lorsque Mitia fait bombance à Mokroïs avec Grouchegnka et les polonais :
«“ - Je suis déjà ivre... de toi, et je veux l’être de vin.”. Il but encore un verre et, à sa grande surprise, ce dernier verre le grisa tout à coup, lui qui avait supporté la boisson jusqu’alors. A partir de ce moment, tout tourna autour de lui, comme dans le délire. Il marchait, riait, parlait à tout le monde, ne se connaissait plus.» [2, 93]
A l’instar de Stocker [4], nous pouvons comparer Mitia à une toupie. Ce n’est pas pour rien que Dostoïevski a intitulé la confession de Mitia : “Confession d’un coeur ardent, la tête en bas”.
Mitia accomplit le parricide en parole. C’est le fameux “Pourquoi un tel homme existe-t-il ?” déjà mentionné. A la suite de cette question - qui est en fait une affirmation, un “delenda est” - le père Karamazov s’écrie immédiatement :
“L’entendez-vous, moines, l’entendez-vous, le parricide,...” [1, 124]
Et c’est un peu plus bas dans la même page que Zossima se prosternera devant Mitia... Ce dernier accomplit le parricide en parole une seconde fois, par écrit, dans une lettre qu’il écrit en état d’ivresse à Katia :
“..., je te donne ma parole d’honneur que j’irai chez mon père, je lui casserai la tête et je prendrai l’argent sous son oreiller, pourvu qu’Yvan soit parti.” [2, 298]
Que Mitia commette le parricide en parole, Berdiaeff n’en doute pas du tout puisqu’il écrit : “Et par cette phrase, il avait consommé le parricide tout au fond de son esprit.” (Berdiaeff, 125]. C’est peut-être dans la mesure où il a pu verbaliser son désir, l’exprimer, que Mitia a pu lier l’affect meurtrier à des mots et non le décharger dans un passage à l’acte.
Examinons maintenant la position de Mitia par rapport à la culpabilité. Je précise qu’il s’agit de sa position dominante, préférentielle, telle qu’elle est repérable avant le meurtre et les changements de position qu’il entraîne. Mitia étant dans un rapport de rivalité narcissique en miroir avec son père, cet autre n’est pas pour lui un “toi” mais un “il”, un “lui” qui est un “moi”. Par conséquent, nous ne devons pas nous étonner de voir la culpabilité s’objectiver, prendre figure, dans un complément d’objet direct, dans ce qu’il faut littéralement appeler un accusatif :
“Mitia ne broncha point. La lumière éclairait nettement le profil détesté du vieillard, avec sa pomme d’Adam, son nez recourbé, ses lèvres souriant dans une attente voluptueuse. Une colère furieuse bouillonna soudain dans le coeur de Mitia : “Le voilà, mon rival, le bourreau de ma vie”.” [2, 41]
C’est là une façon de dire : c’est lui le coupable. Cependant, étant donné le rapport en miroir, la culpabilité déplacée sur l’objet accusé B (le père) fait facilement retour, dans un mouvement de réversibilité immédiate, sur l’objet accusateur A (le fils). Autrement dit, Mitia a une certaine conscience de sa propre culpabilité corrélative à celle qu’il attribue à son père; nous en avons la preuve dès le début du roman dans ce que Mitia déclare aux moines lors de la rencontre avec le starets :
“J’étais venu dans l’intention de lui pardonner et de lui demander pardon. Mais comme il vient d’insulter non seulement moi, mais la jeune fille la plus noble, (...) j’ai décidé de le démasquer publiquement, bien qu’il soit mon père.” [1, 122]
Le discours de Mitia est un discours en spirale, un tourbillon qui tourne, la valse de toupie de son désir parricide qui l’enivre de haine et d’amour et qui l’aspire en son centre. Pour étudier le discours type de Mitia, il faut nous rapporter à ce que Dostoïevski a intitulé : “Confession d’un coeur ardent, la tête en bas”, ce long monologue déclamé devant Aliocha sidéré. La propriété de ce discours, c’est qu’il saoule de paroles, qu’il entraîne l’auditeur-spectateur dans une valse infernale, qu’il le fait taire, parlant pour lui et à sa place; illustrons notre propos par quelques exemples :
“Je me suis mis à parler secrètement, à chuchoter comme un sot, sans raison. Allons, viens et tais-toi.” [1, 161]. Mitia parle tout seul (il demande à Aliocha de se taire : pp. 161, 162, 163, 169)
“Assieds-toi à table, près de moi, que je te voie. Tu m’écouteras en silence, et je te dirai tout,...” [1, 162] Mitia veut voir et être vu : l’auditeur devient un spectateur;
Suite au discours de son frère, Aliocha se trouve entraîné “dans une agitation extraordinaire” [179]. Quant à Mitia, “Il avait l’air ivre. Ses yeux étaient injectés de sang.” [181] - Mitia déclare d’ailleurs à Aliocha : “Sais-tu, innocent, que tout ceci est un vrai délire, un délire inconcevable,..” [181] Il entraîne Aliocha dans une valse.
Devant Aliocha, Mitia n’a pas honte mais s’exhibe : “Crois-tu que je t’ai appelé seulement pour te débiter ces horreurs ? Non, c’est afin de te raconter quelque chose de plus curieux; mais ne sois pas surpris que je n’aie pas honte devant toi; je me sens même à l’aise.” [168]
Enfin, examinons brièvement la position de Mitia par rapport à cette catégorie de l’éthique qu’est le droit. C’est en effet au droit que se rapporte préférentiellement Mitia, être éminemment discursif.
Comme nous l’avons déjà mentionné, Dostoïevski nous informe au début du roman que Mitia a entamé une action en justice contre son père. A la fin du roman, c’est Mitia qui se retrouve en justice mais en tant qu’accusé cette fois. Il est le seul des frères Karamazov dont Messieurs les juristes s’emparent. Mitia témoigne d’un esprit vindicatif et revendicatif. Il revendique le respect de ses droits. Le français “revendiquer” est issu du substantif “revendication”, lui-même dérivé du latin juridique “rei vindicatio”; le “rei vindicatio” est l’action en justice de réclamer un bien. Dès l’ancien droit romain ou “droit quiritaire” [5], dès 1450 A.J.C., l’action en justice, le noyau du droit, est une action de revendication : “meum esse ex jure quiritium” : “je dis que cette chose est mienne en vertu du droit des quirites”. Seul le père, le “Pater” - unique personne - a le droit de revendiquer puisqu’il est le seul propriétaire légalement reconnu (ni sa femme, ni ses enfants, ni ses gens, qui pour le droit ne valent en rien).
Mitia a une affinité pour la catégorie du droit parce qu’il est celui des frères qui revendique son bien : il est celui dont les revendications pulsionnelles se font le plus clairement entendre sur la place publique. Il est celui pour lequel se pose de la manière la plus pressante la question de la jouissance de ce bien qu’est l’héritage de la mère. Son “bien” n’est pas un bien moral qui s’opposerait à un mal immoral. Non, il s’agit du “bien” objet de droit, de la chose au sens juridique du terme, de ce dont une personne (sujet du droit) revendique la jouissance. Mitia est donc l’homme du droit au sens du génitif objectif et subjectif.
3. Yvan
Yvan est bien celui des frères qui s’exclut de lui-même du terrain pour laisser le champ libre à l’assassin Smerdiakov :
““Pourquoi donc, interrompit-il brusquement, me conseillerais-tu de partir à Tchermachnia ? Qu’entendais-tu par là ? Après mon départ, il arrivera ici quelque chose.” Il haletait. “Tout juste, dit posément Smerdiakov, tout en fixant Yvan Fiodorovitch. - Comment tout juste ? répéta Yvan Fiodorovitch, tâchant de se contenir, le regard menaçant. - J’ai dit tout cela par pitié pour vous. A votre place, je lâcherais tout... pour m’écarter d’une mauvaise affaire”, réplique Smerdiakov d’un air dégagé. Tous deux se turent.” [1, 370]
Et quelques pages plus loin :
“Tu vois, je vais à Tchermachnia” ... laissa tout à coup échapper Yvan comme malgré lui et avec un rire nerveux. Il se le rappela longtemps ensuite. - “C’est donc vrai, ce qu’on dit : il y a plaisir à causer avec un homme d’esprit”, répliqua Smerdiakov avec un regard pénétrant.” [1, 377] “Pourquoi y a-t-il plaisir à causer avec un homme d’esprit, qu’entendait-il par là ? se demanda-t-il soudain. Pourquoi lui ai-je dit que j’allais à Tchermachnia ?” [1, 377]
Tout le dialogue entre Yvan et Smerdiakov se passe en sous-entendus. Smerdiakov est bien conscient de ce qu’il suggère à Yvan. Yvan n’en est pas conscient mais dans son “inconscient”, il a compris le sens caché de la suggestion de Smerdiakov (il est à noter que le père Karamazov a lui-même insisté pour qu’Yvan s’en aille à Tchermachnia).
Ce décalage à l’intérieur d’Yvan, entre ce qu’il sait et ce qui’il ne veut pas savoir, nous indique qu’Yvan est décentré par rapport au désir parricide. Je vais citer littéralement et assez longuement Mikhail Bakhtine qui a parfaitement analysé la structure du discours d’Yvan; il écrit :
«“ Je ne souhaite pas le meurtre de mon père, s’il a lieu ce sera en dépit de ma volonté. Mais je veux que le meurtre ait lieu en dépit de ma volonté car alors j’y serai intérieurement étranger et n’aurai rien à me reprocher.” Telle est, écrit Bakhtine, la structure du dialogue intérieur d’Yvan avec lui-même. Smerdiakov en devine, plus exactement en entend nettement, la seconde réplique, mais interprète à sa façon l’échappatoire qu’elle contient : comme le désir d’Yvan de ne laisser aucun indice prouvant sa participation au crime, comme l’extrême prudence extérieure et intérieure d’un “homme intelligent”, évitant tout mot direct qui pourrait l’accuser et avec lequel de ce fait, “il y a plaisir à causer” : on peut lui parler par allusions. Pour Smerdiakov, la voix d’Yvan avant le meurtre est une conclusion absolument évidente et naturelle de ses conceptions idéologiques et de son affirmation que “tout est permis”. Il n’entend pas la première réplique du dialogue intérieur d’Yvan, et ne croira pas jusqu’à la fin que sa première voix ne voulait réellement et sérieusement pas la mort du père.” [Bakhtine, p. 334]
Yvan ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, de sa deuxième voix. Smerdiakov s’adresse par ses allusions à la voix cachée qu’Yvan lui-même veut ignorer. Les mots de Smerdiakov s’adressent donc à la deuxième voix alors que c’est la première qui lui répond Il s’ensuit que la première voix (consciente) d’Yvan qui répond à Smerdiakov “est entrecoupée ça et là par des répliques cachées de la seconde voix.”. [Backhtine, 335]. Par rapport à sa seconde voix, Yvan est décentré : il ne veut pas regarder de ce côté-là mais fait un effort désespéré “pour contourner quelque chose qui de l’intérieur modèle déjà sa pensée et son discours, et qui est la “vérité” invisiblement présente.” [Bakhtine, 319]. On peut dire qu’Yvan se cache quelque chose qui lui reste cependant constamment devant les yeux. Comme l’écrit très bien Bakhtine :
“L’évolution de la vie intérieure d’Yvan Karamazov, décrite par le roman, est dans une large mesure un processus de reconnaissance et d’affirmation pour soi et pour les autres de ce qu’en fait il sait depuis longtemps.” [p. 320]
On dirait Freud parlant de l’analyse d’un hystérique. Si Smerdiakov parvient à s’emparer de la voix cachée d’Yvan, c’est dans la mesure où ce dernier refuse justement de regarder de ce côté-là. Le fait que le discours de Smerdiakov noyaute le discours d’Yvan (en s’adressant à sa seconde voix) va introduire une polémique cachée, intérieure, dans le discours d’Yvan.
Alors que Mitia tente de remplacer la voix d’autrui par la sienne propre, la voix d’Yvan subit l’intrusion de celle de Smerdiakov. La lutte contre cet ennemi intérieur va produire des dissonances particulières dans le discours d’Yvan. Voici comment les décrit Bakhtine :
“ Ces dissonances dans la voix d’Yvan sont très subtiles et ne se traduisent pas tant dans les mots que dans des silences que ne justifie par le sens de son discours, dans des changements de ton inexplicables par rapport à sa première voix, dans un rire déplacé, etc...” [p. 335]
C’est la raison pour laquelle on peut parler du discours d’Yvan comme d’un discours en pointillé : il est rempli de points de suspension, de cassures, d’interruptions, qui ne sont que la manifestation en surface d’un combat que se livrent ses voix contradictoires qui se coupent continuellement avec une extrême agressivité. Un tel type de discours freiné et interrompu est particulièrement caractéristique : il nous fait penser à ces phénomènes de parole dans lesquels Freud débutant décelait le travail de la résistance chez les hystériques.
On peut donc dire d’Yvan qu’il commet le parricide en pensée puisque, si sa seconde voix lui demeure cachée, il n’en pense cependant pas moins. Ce qui fait écrire à Berdiaeff :
“Yvan accomplit le crime en esprit, en pensée; Smerdiakov le perpètre effectivement, donne un corps à l’idée d’Yvan.” [p. 187]
Quelle est alors la position d’Yvan par rapport à sa culpabilité ? Deux choses sont d’abord à constater :
a) Yvan intervient comme tiers dans la querelle entre Mitia et son père (voir ci-avant); b) contrairement à ce que disent les commentateurs, s’il y a bien une collusion secrète entre Yvan et Smerdiakov, il ne s’agit pas d’un rapport en miroir (double) puisqu’il se situe au niveau d’un dialogue (redoublé du côté d’Yvan dans une polémique intérieure), dialogue plein de sous-entendus entre les deux hommes. On doit donc s’attendre à ce qu’autrui, pour Yvan, ne soit pas “lui” mais un “toi”, un “tu” véritable. Et effectivement, au moment où l’ambivalence, la contradiction interne d’Yvan s’accentue au maximum, c’est-à-dire lors de ses trois derniers entretiens avec Smerdiakov au cours desquels Yvan s’acharne à se démasquer et à se cacher, à faire, pourrait-on dire, hurler ses deux voix simultanément ou l’une après l’autre, que constate-t-on ?
Yvan sait à ce moment-là que si Smerdiakov est innocent, c’est sa première voix qui a été entendue par ce dernier, et que par conséquent, lui-même, Yvan, est innocent; par contre, si Smerdiakov est coupable, Yvan sait que c’est sa deuxième voix qui a été entendue par Smerdiakov, et que, par conséquent, elle existe cette deuxième voix, et qu’il est coupable, lui, Yvan. Poussé par lui-même dans ses derniers retranchements, Yvan va prendre parti tantôt pour la première hypothèse, tantôt pour la seconde. Mais ce qui nous importe, c’est de constater qu’Yvan ne peut accepter ou refuser sa propre culpabilité que via celle qu’il attribue à un autrui qui n’est pas pour lui sa propre image : cet autrui est un “toi”, un “tu” avec lequel il a parlé et parle encore et dont il est le répondant; Smerdiakov n’est pas son double mais son complice, c’est-à-dire, étymologiquement parlant, son “complex”, celui auquel il est “uni étroitement” :
«“ C’est toi qui l’as tué” s’écria-t-il soudain, Smerdiakov sourit, dédaigneux.» [2, 293]
«“- Tu as menti, ce n’est pas toi qui a tué” rugit Yvan. “Tu es fou, ou tu m’exaspères à plaisir, comme l’autre fois.”» [2, 304]
Rien que ce que nous venons de dire concernant cette deuxième voix d’Yvan suffirait déjà à nous convaincre qu’Yvan veut rester moral même dans la complicité d’un meurtre car cette deuxième voix dit :
“... je veux que le meurtre ait lieu en dépit de ma volonté car alors j’y serai intérieurement étranger et n’aurai rien à me reprocher.” [Bakhtine, 334]
Traduisons : si le meurtre a lieu, ce sera à cause des circonstances, le hasard faisant que je devais justement me rendre à Tchermachnia; mais, face à moi-même et à autrui, je n’aurai pas à m’en sentir responsable. Les circonstances auront simplement bien fait les choses; intérieurement, je n’aurai rien à me reprocher ... Dans la mesure où l’on définit classiquement la moralité d’un homme par la qualité de son adhésion intérieure à une action commise soit par lui-même, soit par autrui, dans le cas précité, Yvan serait moralement irréprochable.
Mais cette définition de la moralité est par trop étroite et même incorrecte; à la suite de plusieurs chercheurs en ce domaine, nous avons préféré voir dans la moralité l’instance critique du droit. Et c’est alors qu’Yvan se révèle être un moraliste.
Dès l’ancienne Rome déjà et son droit quiritaire, la morale avait pour fonction d’adoucir les rigueurs du droit. Aujourd’hui encore, la moralité est ce qui critique le droit jusque dans ses fondements. Autrement dit, contrairement à ce que pense un Kelsen, le droit ne s’auto-fonde pas mais il a à se fonder en dehors de lui-même. Yvan nous apparaît donc comme un moraliste dans la mesure où il va faire une critique morale du droit en vigueur dans la Russie de la fin du 10ème siècle :
“Il y a longtemps que le peuple russe appelle l’avocat une “conscience à louer”. Le défenseur plaide pour son client : “l’affaire est simple; c’est une scène de famille, comme on en voit tant. Un père a fouetté sa fille, c’est une honte de le poursuivre.” Le jury est convaincu, il se retire et rapporte un verdict négatif. Le public exulte de voir acquitter ce bourreau. Hélas, je n’assistais pas à l’audience. J’aurais proposé de fonder une bourse en l’honneur de ce bon père de famille.” [1, 332] (voir aussi les exemples qui suivent, notamment l’épisode du général, [pp. 332-333-3341]).
D’autre part, le bien auquel s’intéresse Yvan n’est pas le bien au sens de la chose juridique (Mitia) mais le bien moral en tant qu’il se définit dans son opposition au mal. Et Yvan va critiquer et dénoncer comme immoral le mode de connaissance de la différence entre le bien et le mal qui nécessite le passage par l’expérience de l’injustice et de la souffrance des innocents :
“On dit que tout cela est indispensable pour établir la distinction du bien et du mal dans l’esprit de l’homme. A quoi bon cette distinction diabolique payée si chère ? Toute la science du monde ne vaut pas les larmes des enfants.” [1, 333]
Certes, Yvan est contradictoire, nous l’avons vu, il est théoricien du “Tout est permis”. Il opère une réflexion critique sur les fondements ultimes du droit : est-ce Dieu ? Cela doit-il être la raison ? Il s’interroge sur ce que l’homme est en droit de revendiquer légitimement : qu’est-il permis ? Qu’est-ce qui est interdit ?
4. Aliocha
En quoi peut-on dire qu’Aliocha est celui des frères qui inclut ? Nous savons que tout au début du roman, le père Karamazov et ses fils sont réunis, dans un esprit d’apaisement, dans la cellule du starets Zossime; même si ce n’est pas Aliocha qui eut l’initiative d’une telle réunion, unique en son genre dans le roman, même s’il nous est dit que cette initiative lui déplut et l’effraya, il n’en demeure pas moins qu’en tant qu’homo religiosus, Aliocha, solidaire de son starets, collabore à réunir sa famille au monastère, lieu sacré, entouré d’une enceinte. Dans “les frères Karamazov”, la fonction du religieux, qu’il s’agisse de Zossime ou d’Aliocha, est toujours de relier, de réunir, de réconcilier, d’inclure en un même lieu d’apaisement les contraires qui s’affrontent.
Cependant, Aliocha est celui qui inclut dans un autre sens aussi et ce sens me semble d’une importance capitale du point de vue psychologique. Jean Mélon a vu en filigrane, dans les quatre vecteurs szondiens, les quatre fantasmes originaires de Freud et il a opéré un rapprochement entre le vecteur paroxysmal (celui où se passe le roman) et le fantasme originaire de la scène primitive. Nous avons constaté que Smerdiakov (e-) est celui qui est exclu par le père de la scène, que Mitia (hy+), le voyeur, cherchait à s’y inclure pour prendre la place du père, qu’Yvan (hy-) cherchait quant à lui à interrompre la scène en s’en excluant; Aliocha (e+) est celui dont le fantasme est de réunir à nouveau dans le fantasme du père les parents dispersés :
“Un an avant la fin de ses études, il déclara soudain à ces dames qu’il partait chez son père pour une affaire qui lui était venue en tête.” [1, 56]
“Comme son père lui demandait pourquoi il n’avait pas achevé ses études, il ne répondit rien mais se montra plus pensif que d’habitude. Bientôt on constata qu’il cherchait la tombe de sa mère. Il avoua même n’être venu que pour cela.” [1, 56]
“L’arrivée d’Aliocha influa sur son moral (NB : le père) et des souvenirs qui dormaient depuis longtemps se réveillèrent dans l’âme de ce vieillard prématuré : “Saisis-tu, répétait-il à son fils en l’observant, que tu ressembles à la possédée ?”” [1, 57]
“J’ai déjà raconté qu’ayant perdu sa père à quatre ans, il se rappela toute sa vie son visage, ses caresses “comme s’il la voyait vivante”. De pareils souvenirs peuvent persister (chacun le sait), même à un âge plus tendre, mais ils ne demeurent que comme des points lumineux dans les ténèbres, comme le fragment d’un immense tableau qui aurait disparu.” [1, 53]
Aliocha est celui qui fait se souvenir le père de la mère d’Aliocha et de lui-même enfant, celui qui inclut dans l’esprit du père, en un souvenir de famille, les membres dispersés. Le père n’est pas exclu (e-) mais inclus avec la mère et le fils (e+, la “sainte” famille).
Je voudrais, avant de poursuivre la description de la position propre à Aliocha, citer une phrase de Dostoiëvski à son propos qui résume à merveille, en une seule formule, les propriétés caractéristiques de cette position :
“Dans son enfance et sa jeunesse, il se montra plutôt concentré et même taciturne, non par timidité ou sauvagerie, mais par une sorte de préoccupation intérieure si profonde qu’elle lui faisait oublier son entourage. (...) Quelque chose en lui révélait qu’il ne voulait pas se faire le juge d’autrui.” [1, 53]
Retenons ces quatre propriétés :
a) Aliocha est l’homme de la concentration; b) il est l’homme de l’intériorité; c) il lui arrive, étant donné cette
concentration et cette intériorité, d’oublier d) il ne veut pas juger autrui.
En principe, idéalement, Aliocha se voudrait à la fois “intérieur” et extérieur, attentif, réaliste :
“ il me semble qu’Aliocha était plus que n’importe qui réaliste” [1, 60].
Par rapport à son désir parricide, Aliocha est concentré (et donc, corrélativement, il est oublieux). Qu’est-ce que cela veut dire ? Le désir parricide est donc le centre du roman. Smerdiakov par rapport au centre est excentré; Mitia est dans l’axe du désir parricide; Yvan est décentré par rapport à ce désir : il a un pied dedans, l’autre dehors; Aliocha est tout cela à la fois et quelque chose en plus : il fait de ce désir son propre centre, il se concentre sur lui afin de le transmuer. Mitia est lui-même aspiré au centre de la spirale de ce désir, emporté par la tourmente; Yvan se décentre : il tâche d’en sortir, il est à la fois dedans et dehors; Aliocha en sort complètement dans un premier temps pour, dans un second temps, prendre en lui ce désir et s’y concentrer et, s’il n’oublie pas l’existence de ce désir (s’il s’y concentre), il pourra peut-être éviter le pire. Donc : Smerdiakov est le plus extérieur par rapport au désir parricide et c’est lui qui passe à l’acte; Aliocha est celui qui intériorise le plus ce désir; Mitia et Yvan occupent des positions intermédiaires :
Mais la concentration d’Aliocha peut revêtir aussi un autre sens : il est centré avec (cum) ses frères : il est dans le bain ou dans le pétrin avec eux; les frères sont solidaires dans le crime comme dans le salut.
Étant donné que la position d’Aliocha est une position de solidarité, on comprend que du point de vue de la culpabilité, il va défendre l’idée de l’omniculpabilité, culpabilité “homoousienne” (Evdokimov), c’est-à-dire consubtantielle aux quatre frères. Mais avant de dire quelques mots de cette omniculpabilité, je voudrais parler de la culpabilité d’Aliocha (qui donc est coupable pour les trois autres et lui-même).
Aliocha est le premier des frères qui va reconnaître SA culpabilité personnelle, suite à ce que Freud appellerait trois causes occasionnelles :
a) le petit Illioucha accuse Aliocha d’être un Karamazov et il le mord; Aliocha n’y comprend rien mais ressent de la culpabilité (en fait le petit garçon sait que Mitia a humilié son père) [1, 256];
b) Aliocha a commis certaines maladresses dans la relation entre Yvan et Catherine, à savoir que, contre l’avis général qui tente de rapprocher Dmitri de Catherine Yvanovna, Aliocha s’efforce de rapprocher Catherine et Yvan, cette tentative ayant pour effet de repousser Dmitri vers Grouchegnka et donc de réactiver la rivalité entre Dmitri et son père; donc par cette erreur maladroite, Aliocha provoque la rivalité entre son frère et son père, ce qui va dans le sens de pousser au parricide, d’où la culpabilité consécutive d’Aliocha [1, 270-274-276];
c) Aliocha commet également une maladresse vis-à-vis du capitaine en retraite Sniéguirov, le père d’Illioucha que Dmitri a humilié publiquement; voulant réparer la faute de son frère, Aliocha en remet; d’où, à nouveau, surgissement de sa culpabilité [1, 301].
Aliocha reconnaît donc SA culpabilité (il ne sait pas encore qu’elle a avoir avec le parricide) et il reconnaîtra plus tard que SA culpabilité est étroitement intégrée ou liée à celle de ses trois frères. Car en tant que religieux, Aliocha reprend l’axiome du starets Zossime (idée que ce dernier a repris à son propre frère, Marcel, qui s’était converti) :
“... chacun de nous est coupable devant tous pour tous et pour tout, et moi plus que les autres” [1, 388]
Or, il apparaît que la reconnaissance de l’omniculpabilité est une manière de transmuer la culpabilité, de la faire déboucher sur autre chose qu’elle-même. En quoi peut-on dire avec Dostoïevski que cette omniculpabilité est la porte du salut ?
1) elle permet à l’individu de réintégrer une totalité, le “suicide total” consistant en ce que “tous se sont fractionnés en unité “[1,407]; la culpabilité supportée par tous, partagée dans la solidarité, est plus facile à porter pour l’individu;
2) cette culpabilité, de par son universalité totalisante, est grâce et non accablement, joie et allégresse, accord avec la totalité de la vie (Marcel demandait pardon aux oiseaux) [1, 389; Evdokimov : 6, 86-87-88-89-357];
3) la culpabilité infinie permet de faire le saut vers la responsabilité [1, 428] et elle se change en amour infini [1, 236 et 276] : “L’amour agissant, c’est le travail et la maîtrise de soi, et pour certains, une vraie science” [1, 102]; en pardon total (cf. l’extase d’Aliocha) : “il peut tout pardonner, à tous et pour tout, car c’est lui qui a versé son sang innocent pour tous et pour tout” [1, 337];
4) l’innocent prend sur lui la culpabilité du coupable [1, 429] et le coupable hérite de l’innocence de l’innocent [1, 430], d’où il s’ensuit que la culpabilité est vaincue : il n’y a plus rien à pardonner.
Smerdiakov, en première position du circuit (e-), nie radicalement la culpabilité qui, revenant au galop, le fera tuer; Aliocha, en dernière position (e+), accepte radicalement la culpabilité, ce qui lui permet de la dépasser.
Aliocha commet le parricide par omission ou, plus précisément, par défaut; le désir parricide qui existe chez lui s’exprime de manière très déguisée :
1) au début du roman, Aliocha pense fuir le monde (du parricide, du conflit frères-père) mais le starets Zossime le renvoie au milieu de ses frères qui ont besoin de lui [1, 128];
2) Aliocha perd sa concentration ou encore, ce qui revient au même, oublie de s’occuper de son frère Dmitri (s’occuper = travailler avec lui à la réconciliation avec le père) [1, 361; 2, 188] alors qu’il sait bien qu’il y a danger que Dmitri tue le père et que donc , il doit veiller sur lui et non pas l’oublier; or, il va oublier [1, 252] (voir le contraste frappant encore [1, 252] et [1, 361] :
“Mon père est irrité et méchant, il demeure ancré dans son idée. Dmitri s’est lui aussi affermi et doit avoir un plan ... il faut absolument que je le rencontre aujourd’hui...”
Mais Aliocha se laisse distraire, divertir et :
“Plusieurs fois dans la suite, il s’étonna d’avoir pu, après le départ d’Yvan, oublier si totalement Dmitri, qu’il s’était promis, le matin même, de rechercher et de découvrir, dût-il passer la nuit hors du monastère”.
3) Aliocha se ment et ment à Yvan en ne voulant pas croire à la possibilité du parricide (comparer [1, 208 et 211] avec [2, 290];
4) comme nous l’avons vu, il organise inconsciemment le conflit Mitia-Fiodor, en poussant Mitia dans les bras de Grouchegnka ou, plus exactement, en rapprochant Yvan de Catherine (donc en écartant indirectement l’idée d’un rapprochement Mitia-Catherine); ici, Aliocha est actif dans l’organisation du parricide.
Cette présence du désir parricide chez Aliocha, telle qu’elle s’exprime en se donnant comme absente, par défaut ou omission, conserve au discours d’Aliocha une droiture apparente qui lui permet de se développer en ligne droite. Tout comme Smerdiakov, Aliocha développe un discours pénétrant (“mot pénétrant” selon Bakhtine), ferme, et il regarde également l’interlocuteur dans les yeux :
“- Tu sais toi-même qui, fit Aliocha d’une voix basse et pénétrante.” [2, 279]
“- Ce n’est pas toi qui as tué, pas toi, répéta avec fermeté Aliocha.” [idem]
“Aliocha pâlit, regarda en silence son frère dans les yeux.” [2, 290]
“... : il y a plaisir à causer avec un homme intelligent, répondit fermement Smerdiakov avec un regard pénétrant” [1, 377; I, 361 à 371]
Cependant, il y a dans le discours d’Aliocha de la douceur alors que celui de Smerdiakov n’est que froideur. Le discours de Smerdiakov meurtrit, blesse; celui d’Aliocha s’efforce de déculpabiliser. Bakhtine a raison de souligner que Smerdiakov s’empare de la voix cachée d’Yvan alors qu’Aliocha fait crédit à son frère : il entend et répond à la voix consciente d’Yvan qui affirme qu’il ne désire pas le parricide. Mais Aliocha aurait peut-être pu entendre la voix cachée afin de ne pas laisser cette part-là d’Yvan à Smerdiakov seul. Il aurait pu aider Yvan à prendre conscience de son désir parricide. Yvan ne serait pas parti pour Tchermachnia, Smerdiakov n’aurait pas interprété ce départ comme une caution et n’aurait pas tué. Mais Aliocha n’a pas voulu entendre (cf. Bakhtine, p. 320-330-334].
En quoi alors, étant donné ce qu’on vient de dire, Aliocha est-il l’homme de l’éthique ? Soyons concret, partons d’un passage du roman :
“Cependant il aimait ses semblables, et toute sa vie, sans passer jamais pour nigaud, il eut foi en eux. Quelque chose en lui révélait qu’il ne voulait pas se faire le juge d’autrui. Il paraissait même tout admettre, sans réprobation, quoique souvent avec une profonde mélancolie. Bien plus, il devint dès sa jeunesse inaccessible à l’étonnement et à la frayeur. Arrivé à vingt ans chez son père, dans un foyer de basse débauche, lui, chaste et pur, il se retirait en silence quand la vie lui devenait intolérable, mais sans témoigner à personne ni réprobation, ni mépris. Son père, que sa qualité d’ancien parasite rendait fort sensible aux offenses, lui fit d’abord mauvais accueil : “il se tait, disait-il, et n’en pense pas moins”; mais il ne tarda pas à l’embrasser, à le caresser; c’étaient à vrai dire des larmes et un attendrissement d’ivrogne, mais on voyait qu’il l’aimait de cet amour sincère, profond, qu’il avait été jusque-là incapable de ressentir pour qui que ce fût ...” [1, 53]
Aliocha ne fait pas la morale, au contraire d’Yvan qui, avec son “Tout est permis”, se permet de juger, de dénoncer, de s’indigner, lui qui déclarait : “je n’ai jamais pu comprendre comment on pouvait aimer son prochain” [1, 326]. Avec son “Tout est permis”, Yvan fait la morale à tout le monde. Yvan a honte de la conduite de son père (cf. ci-avant). Aliocha est le seul des frères qui témoigne de l’amour pour son père.
Nous entendons le concept d’“éthique” au sens de l’éthos grec (êthos), le concept qui englobe ceux d’habitat, d’habitude, d’habitus, le plus extérieur et le plus intérieur, c’est-à-dire, dans l’ordre et par inclusions conceptuelles successives : la loi, le droit, la morale.
Aliocha est à la fois excentré, centré, décentré, concentré par rapport au désir parricide, c’est-à-dire qu’il est à la fois l’homme de l’intériorité à l’oeuvre pleinement - oeuvre de médiateur entre ses frères - dans l’extériorité (au sens de l’entourage). Sa mission est d’éviter que le parricide ait lieu. Yvan le moraliste est en polémique constante avec lui-même, il ne s’extériorise pas mais s’acharne à être moral, à se faire violence, à nier ce désir qu’il porte en lui et qu’il ne veut pas voir, ni savoir. Aliocha, lui, travaille à aménager un espace d’apaisement où les contraires en opposition pourraient se réconcilier. C’est pour cela que le starets le renvoie auprès de ses frères, dans la maison paternelle.
L’homme du droit s’efforce de positiver la loi : que celle-ci ne soit plus simplement une interdiction mais qu’également et au contraire, elle assure au citoyen le respect de ses droits en les protégeant. De même, l’homme de l’éthique s’efforce de positiver la morale : qu’elle serve donc à autre chose qu’à se faire violence à soi-même; il s’efforce de lever le refoulement, de ne pas “oublier” : (a) l’interdit du parricide; (b) l’existence effective du désir qu’il ait lieu. Autrement dit, l’homme de l’éthique s’efforce de déculpabiliser là où le moraliste culpabilise car l’homme de l’éthique sait que la culpabilité est en elle-même mortifère. L’homme éthique prône la reconnaissance de la culpabilité afin de permettre son dépassement dans une prise de responsabilité :
“il résolut de ne plus “penser” au “mal” qu’il venait de faire, de ne pas se tourmenter par le repentir, mais d’agir;” [1, 276]
Alors que la morale est la négation sur soi de la violence qu’on porte en soi (Kierkegaard verra même dans la moralité un péché ou, du moins, une tentation), l’éthique est la reconnaissance et la transmutation de ce désir. La nature de cette transmutation qui ne doit pas être un refoulement ou une méconnaissance (comme c’est le cas dans la morale) reste inconnue.
L’homme éthique, au sens d’Aliocha Karamazov, s’efforce de travailler à l’accomplissement (réalisation et déplacement) de la loi dans l’amour actif, agissant [1, 102] : la loi n’est pour lui qu’un moyen que l’amour transcende car quand on aime, il n’y a plus rien à pardonner; c’est ce dont font l’expérience tant Mitia que Catherine, à la fin du roman, après que Mitia ait été arrêté, et après qu’il ait reconnu sa culpabilité en rejoignant Aliocha dans sa position quatrième :
«“As-tu pardonné ?” murmura enfin Mitia, et aussitôt, se tournant radieux vers Aliocha, il lui cria : “Tu entends ce que je demande, tu entends...”»
“- Je t’aime parce que ton coeur est généreux, dit Katia. Tu n’as pas besoin de mon pardon, pas plus que je n’ai besoin du tien.” [2, 468]
Le moraliste ne saurait aimer parce qu’il est trop occupé à refouler, à nier la violence qu’il porte en lui. Or, pour vraiment aimer, il faut se savoir capable de tuer. C’est seulement à cette condition qu’on peut faire le choix de ne pas tuer. C’est au-delà du refoulement que se trouve le seuil de l’éthique. Tel est bien, avant Freud, le testament de Dostoïevski.
BIBLIOGRAPHIE
1. F.M. DOSTOIEVSKI, “Les frères Karamazov”, vol. 1, coll. Folio, Gallimard, Paris.
2. F.M. DOSTOIEVSKI, “Les frères Karamazov”, vol. 2, coll. Folio, Gallimard, Paris.
3. Nicolas BERDIAEFF, “L’esprit de Dostoïevski”, Stock, 1974.
4. Arnold STOCKER, “Ame russe, réalisme psychologique des frères Karamazov”, coll. Action et Pensée : 18, Genève, 1945.
5. Mikhaïl BAKHTINE, “La poétique de Dostoïevski”, Seuil, 1970.
6. Paul EVDOKIMOV, “Dostoïevski et le problème du mal”, Desclée de Brouwer, 1978. _______ [1] Cet article constitue la conclusion d’un cours donné à l’U.C.L. durant le second quadrimestre de l’année académique 1982-1983. [2] Cf. J. MELON et Ph. LEKEUCHE, “Dialectique des pulsions”, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 1990. [3] Dans la suite de cette étude, tout ce qui est souligné dans le texte de Dostoïevski l’est par nous. [4] La présente étude revendique la découverte du quatrième frère Karamazov, découverte qui n’aurait pas été possible sans le schéma pulsionnel de Szondi. [5] Des “quirites” : qui concerne le citoyen romain, plus précisément le “pater familias” qui est le seul à avoir la “capacité juridique”, étant seul “sui juris” - c’est-à-dire une personne, sujet de droit, - par opposition au droit applicable au tout venant étranger se trouvant sur le territoire de Rome, autrement dit : “dominum ex jure quiritium” par opposition au “dominum ex jure gentium”. |
 |
 |
© 1996-2002 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev